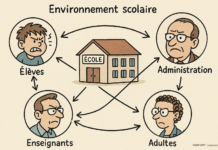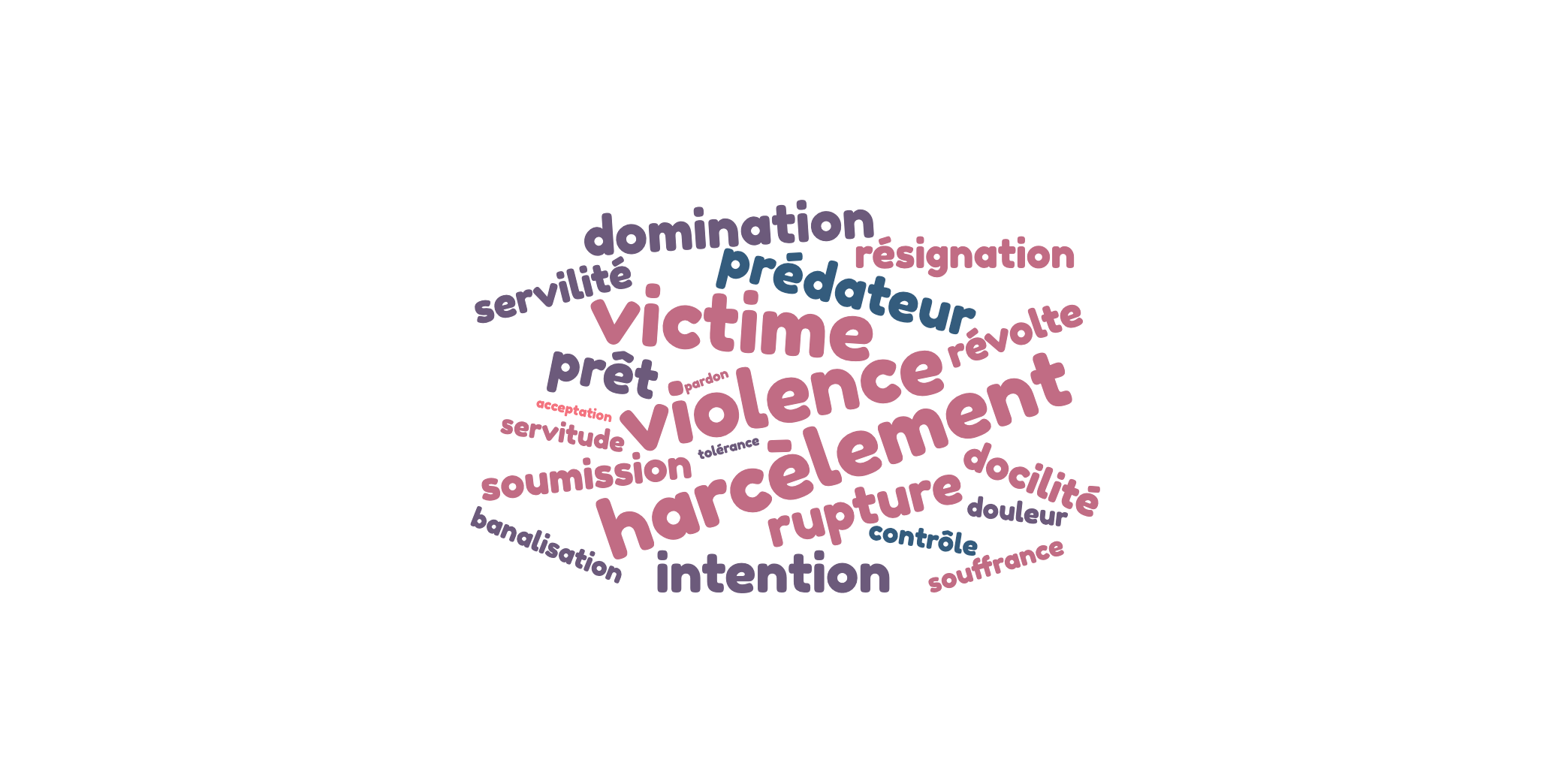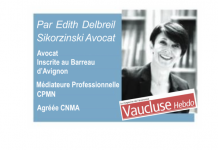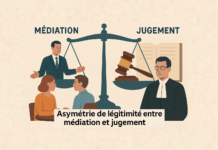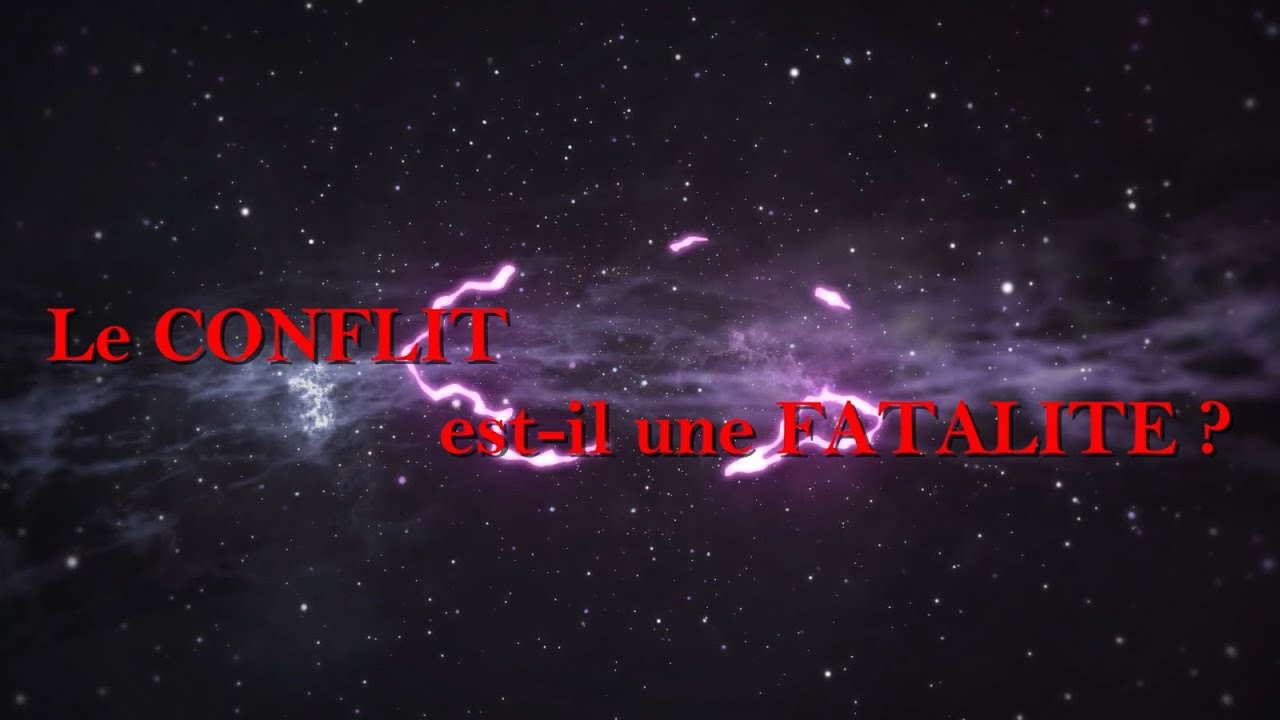Les causes des discriminations font monter des adversités et génèrent parfois des dérives criminelles. La loi n’a jamais suffi et nous assistons plus que jamais à ses limites. Une nouvelle approche basée sur les innovations relationnelles peut contribuer à changer les choses. Quand vous aurez découvert l’altérité, saurez-vous vous en passer ?
L’utilisation de l’intolérance religieuse
Un peu d’Histoire. Dès l’Antiquité, des textes(1) témoignent de tentatives pour réguler les tensions religieuses. De fait, l’exercice de la citoyenneté est longtemps resté indissociable de la pratique religieuse. Dans la Grèce antique, cette conception a prédominé, comme en témoigne la condamnation à mort de Socrate(2), accusé d’impiété. Ainsi, la liberté de culte apparaît comme l’une des premières libertés à avoir nécessité une reconnaissance.
L’intolérance religieuse, nourrie par les incompréhensions du monde et de ce qui fait l’humanité, a constitué un fondement paradoxal de la vie en société. Les limitations autoritaires visaient à homogénéiser les références culturelles pour garantir la soumission (3) organisée au régime en place, au prix d’une liberté de pensée bridée. Un constat s’impose : la loi ne permet pas de réguler de manière pérenne ce phénomène, mais l’enseignement de sa compréhension ne pourrait-il y parvenir ? C’est l’un des enjeux de la proposition qui est faite ici.
Les balbutiements de l’usage de la raison
Avec l’évolution de l’usage de la rationalité, avec l’apport de René Descartes(4), les référentiels culturels ont franchi de nombreux tabous et ont permis de surmonter des blocages dans des domaines variés. Des innovations technologiques en ont résulté. Pour autant, si des évolutions ont eu lieu dans la vie matérielle, avec une multitude de disciplines, les aspects relatifs au fonctionnement de la pensée sont encore sans enseignement initial.
Aujourd’hui, la pensée collective reste marquée par les idées du 17ᵉ siècle. Pour dépasser les limites héritées des schémas anciens, la reprise de la réflexion est indispensable. Au cœur des doutes, nous pouvons augmenter l’usage de la raison. Dans la foulée, l’intégration des concepts tels que l’altérité (5), la médiation professionnelle et l’ingénierie relationnelle(6) ne saurait être superflue. De plus, les conceptions participatives et contributives offrent également des perspectives nouvelles.
La loi de 1905 : cadre historique et limites contemporaines
La laïcité, dérivée du grec laos (peuple), a émergé dans un contexte de conflit entre l’État et l’Église catholique. La loi de 1905 (7) a marqué un progrès décisif pour pacifier les tensions entre l’État et l’Église catholique, en mettant fin au régime concordataire institué par Napoléon. Elle a établi trois principes fondamentaux :
- Liberté de conscience : chacun est libre de croire ou de ne pas croire.
- Neutralité de l’État : aucune religion n’est favorisée et les cultes sont libres.
- Égalité : tous les citoyens sont traités de manière égale devant la loi, sans que la religion interfère.
La loi de 1905, concentrée sur les questions religieuses, montre aujourd’hui ses limites face aux défis de la diversité culturelle et idéologique. Ce cadre juridique, conçu pour répondre aux problématiques conceptualisées dans un autre siècle, peine à s’adapter aux exigences d’un vivre-ensemble inclusif dans une société plus ouverte que jamais.
La mondialisation, les migrations et la montée des communautarismes appellent à repenser ce cadre initial. Une réflexion s’impose pour dépasser ses limites et intégrer les enjeux contemporains de reconnaissance des diversités et de régulation des tensions sociales. La démonstration est encore faite ici que les chemins du droit ne sont souvent ni les plus courts ni les meilleurs.
Les impasses émotionnelles et conflictuelles de la laïcité
En tant que réponse à l’intolérance religieuse, la laïcité est une affaire de droits et d’obligations. La loi conduit à une focalisation sur les pratiques et signes religieux (8). Non seulement elle laisse en marge d’autres discriminations, comme celles liées aux origines culturelles, aux genres ou aux convictions personnelles, mais elle apparaît sous une forme contraignante, alors qu’elle vise à encadrer l’exercice d’une liberté. Par l’entretien d’une polémique, elle fait œuvre paradoxale sans parvenir à répondre à l’intention, celle de participer à la qualité des relations humaines.
Une nouvelle approche est donc nécessaire pour dépasser ces impasses et répondre aux exigences d’une société plurielle.
L’altérité : un nouveau paradigme pour le vivre-ensemble
Dans ce contexte, depuis 2001, une innovation en médiation a été fondée sur l’identification de ce qui fait la qualité relationnelle (9), la dégrade, et ce qui permet de la restaurer. Une approche pédagogique s’est développée, avec l’altérité comme pierre angulaire : la médiation professionnelle. Celle-ci s’appuie sur des méthodologies concrètes qui favorisent la reconnaissance de l’autre dans sa singularité, ce qui est la cheville ouvrière de l’altérité. Elle propose une approche novatrice pour les relations humaines et sociales. Là où la laïcité vise à combattre les tensions religieuses avec les moyens juridiques, l’altérité est désormais outillée de référentiels pour transcender ces tensions.
L’altérité, issue du latin alter (l’autre), invite à reconnaître et valoriser l’autre dans son unicité. Contrairement à la laïcité, qui sépare le religieux de la sphère publique, l’altérité élargit la perspective pour inclure toutes les dimensions des originalités individuelles aux particularismes communautaires. Elle transforme les différences perçues en obstacles en opportunités relationnelles.
En élargissant la perspective, l’altérité permet de sortir d’un cadre binaire qui réduit les individus à leur appartenance religieuse, quelle que soit la représentation, ou non, pour mieux reconnaître l’ensemble des facettes de leur identité.
Une liberté renouvelée
La laïcité repose sur une vision héritée du 17°, le siècle des Lumières : la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres, ce qui tend à provoquer des exclusions. Les différentes conceptions du Contrat Social(10) sont porteuses de ces rapports d’adversité et de “gestion des affrontements” considérés comme naturels.
En revanche, l’altérité repose sur le constat que la liberté de chacun s’étend au travers de celle des autres. Elle s’inscrit dans un nouveau paradigme sociétal : celui de l’Entente Sociale. Dans une relation, imposer ses interdits ou tabous à autrui revient à limiter non seulement la liberté de l’autre, mais également la sienne. Les convictions, croyances ou certitudes individuelles, accompagnées de leurs autorisations et interdits, peuvent ainsi devenir des blocages ou des barrières.
Avec les nouvelles pratiques et connaissances, une autre approche est possible en matière de relations, d’exercice de la liberté et de transmission éducative. L’enseignement de la compréhension des mécanismes de pensée, soutenu par les avancées des sciences cognitives, peut transformer l’éducation. Les avancées en neurosciences montrent que l’exposition répétée à des perspectives différentes modifie les circuits neuronaux, réduisant ainsi les biais et favorisant l’ouverture à l’autre. Les contextes d’apprentissage et de formation continue offrent de nombreuses occasions de promouvoir l’altérité et de réduire les tensions issues interpersonnelles et collectives. Instruire sur la manière dont les idées se construisent, expliquer pourquoi certaines représentations deviennent des obstacles et comment les dépasser, constitue un socle pour transmettre l’altérité.
Les piliers de l’altérité
L’altérité repose sur trois piliers concrets qui favorisent la qualité relationnelle et l’inclusion :
- Enseignement et structuration de la pensée : apprendre à exercer sa liberté et sa responsabilité, tout en cultivant une éthique de vie en société ; apprendre à déconstruire un préjugé en analysant ses origines personnelles et culturelles ;
- Reconnaissance et accueil : dépasser la tolérance et l’acceptation fataliste pour valoriser les différences et les singularités ; mettre en place des ateliers pour pratiquer les différentes formes de la reconnaissance et la diversification du langage et des techniques spécifiques dédiées à l’altérité (altérocentrage, restitution de sens, langage attributif…)
- Dialogue et contribution : inscrire chacun dans des projets relationnels ou collectifs qui renforcent la coopération et le vivre-ensemble.
Ces piliers permettent de dépasser les écueils de la laïcité, de nature contraignante, en promouvant une reconnaissance(11) inclusive d’autrui, fondée sur l’identification des potentialités relationnelles et des contributions de chacun.
| Aspect | Laïcité | Altérité |
| Objectif | Neutralité et régulation des relations entre État et religion | Reconnaissance et valorisation de la diversité humaine |
| Origine | Cadre juridique issu des conflits État-Église | Approche relationnelle basée sur la qualité des interactions |
| Avantages | Égalité devant la loi, liberté de conscience, réglementation des signes religieux dans les écoles | Inclusion des diversités, opportunités relationnelles, dispositifs de médiation professionnelle |
| Limites | Rigidité face à la diversité croissante, participe d’une controverse fixée sur la légitimité religieuse | Nécessite un accompagnement pédagogique et des émissions médiatisées pour favoriser l’évolution éducative et culturelle |
Etes-vous porteur de ce projet ?
- La laïcité a permis un progrès inestimable dans l’histoire des droits humains. Mais les défis de notre temps exigent davantage qu’un cadre juridique, lequel reste pertinent même s’il est perfectible. Ils appellent à une transformation culturelle profonde, portée par l’altérité. Enseigner, reconnaître, dialoguer : c’est ainsi que nous pourrons bâtir un vivre-ensemble qui valorise chaque singularité tout en renforçant la cohésion sociale. Le moment est venu d’agir. Êtes-vous prêt à participer à cette transition ?
Plusieurs collectivités territoriales, ainsi que des organisations publiques et des entreprises privées de tous les secteurs, ont déjà intégré des dispositifs de médiation professionnelle et recours à des programmes de formation centrés sur la qualité relationnelle. Ces initiatives(12) démontrent que cette approche nourrit la culture collective, et qu’elle est aussi pratique et adaptable aux réalités du terrain.
En tant que citoyen, élu, éducateur ou cadre, comment pouvez-vous contribuer à intégrer ces pratiques dans votre environnement ? Le moment est venu d’élargir les repères culturels pour intégrer ces pratiques innovantes dans le quotidien collectif(13). N’hésitez pas à vous former et à inciter des personnes à s’approprier ces pratiques rapidement opérationnelles.
Renvois et sources
- Édit de Gallien (260), a été suivi de plusieurs autres, comme celui de Maximien Galère (311) et celui des co-empereurs Licinius et Constantin 1er, en 313. Chacun a reconnu épisodiquement la liberté de culte aux chrétiens, mettant un terme à des persécutions plus ou moins organisées et systématiques.
- Apologie de Socrate, Platon
- Discours de la servitude volontaire, le Contr’un, Etienne de la Boétie
- Discours de la méthode, René Descartes
- Dictionnaire encyclopédique de la médiation, Jean-Louis Lascoux, ESF
- Pratique de la médiation professionnelle, Jean-Louis Lascoux, ESF
- Loi du 9 décembre 1905 – sur la séparation des Eglises et de l’Etat
- Loi du 15 mars 2004 sur les signes religieux
- epmn.fr – formation à la qualité relationnelle et à la profession de médiateur
- Contrat social, selon Thomas Hobbes, John Locke et Jean-Jacques Rousseau
- Dictionnaire encyclopédique de la médiation, Jean-Louis Lascoux, ESF
- Inventaire Barométrique du Climat Relationnel au Travail – Nexus.
- Livres blancs
- la qualité relationnelle dans les entreprises privées
- la qualité relationnelle dans les fonctions publiques
- la profession de médiateur




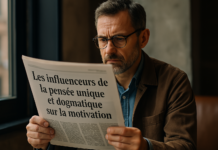

![Livre [nouveauté] : Médiations en milieux hostiles](https://www.officieldelamediation.fr/wp-content/uploads/2023/10/Médiations-en-milieux-hostiles-218x150.png)