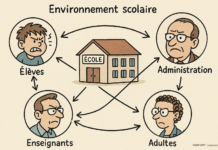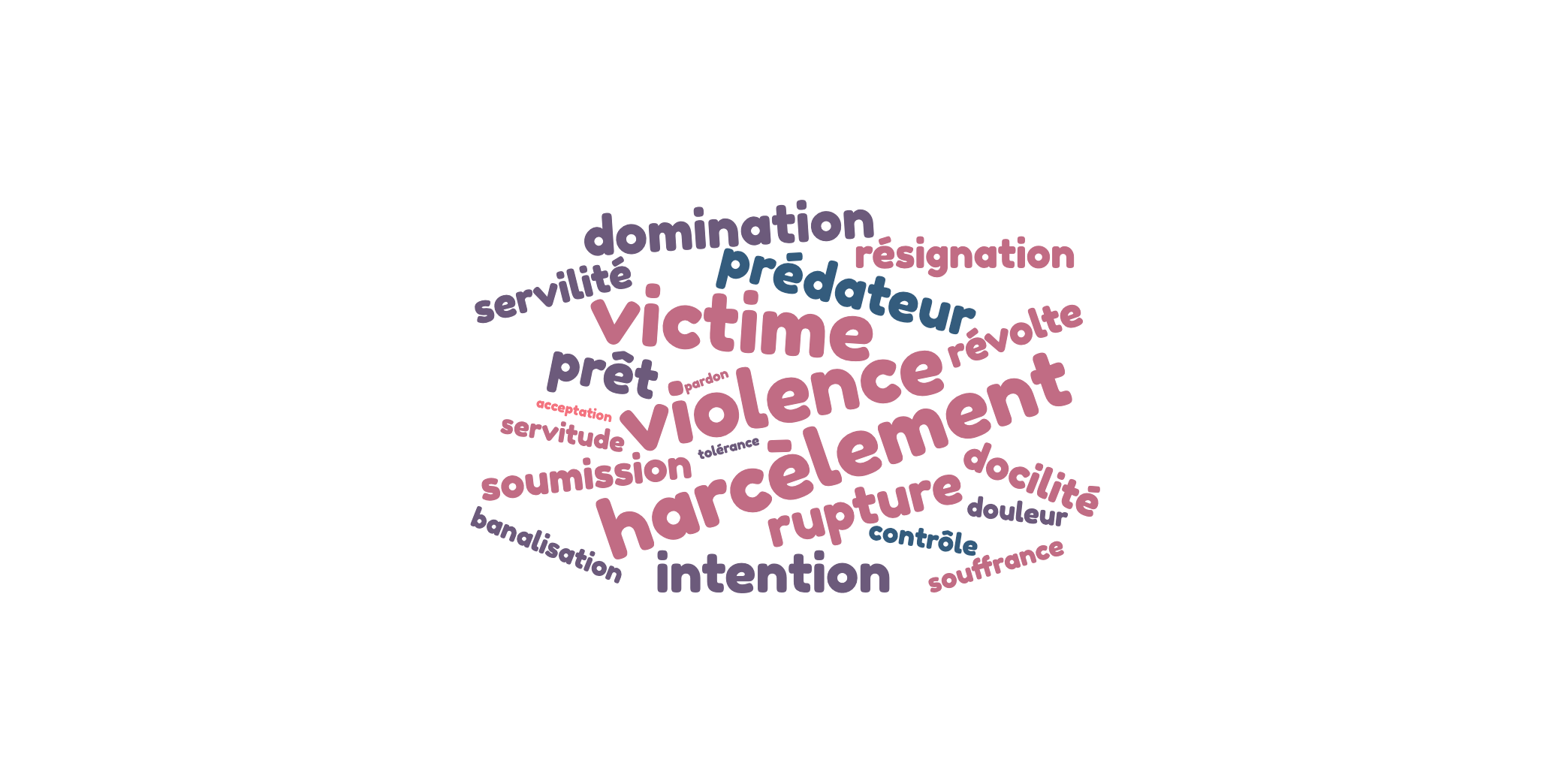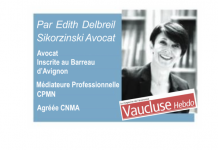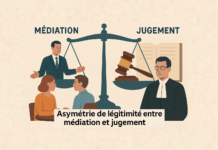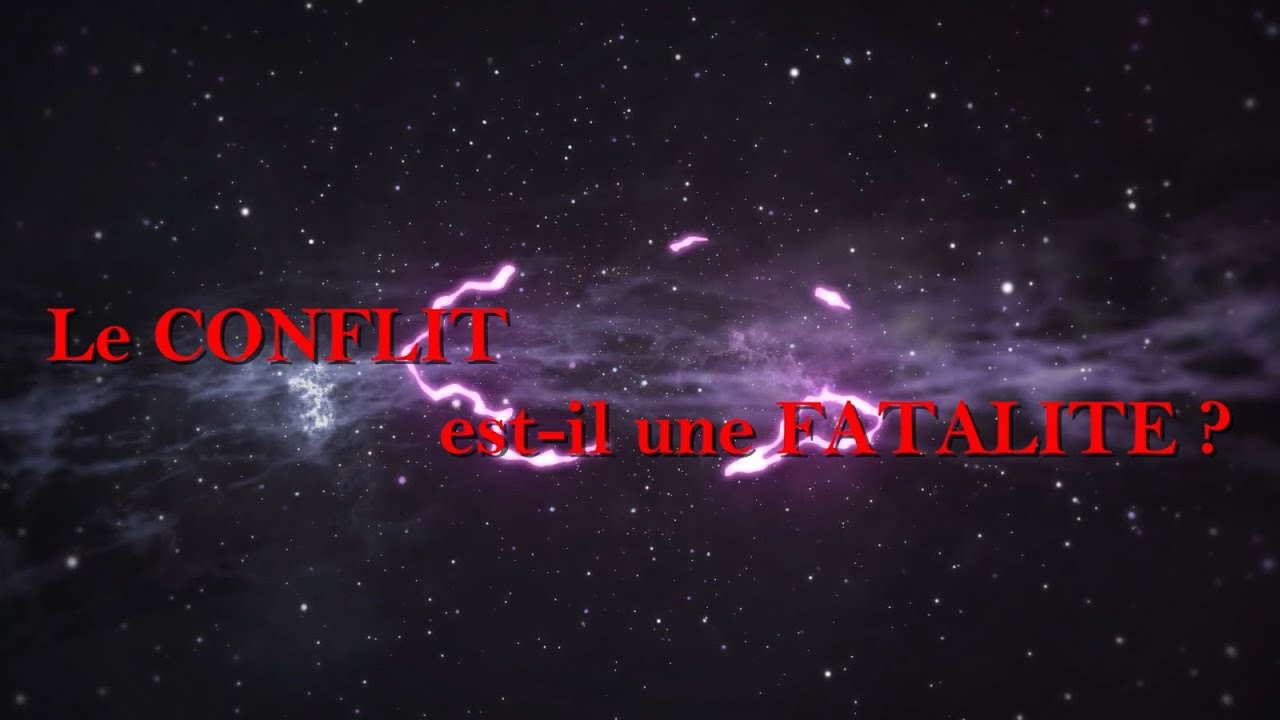En bref : cet article revisite les réactions de professionnels du droit concernant une décision du Tribunal Administratif de Dijon, publiées sous le titre tapageur « La médiation dans la tourmente », le 10 juillet 2025 dans la Gazette des Communes, par Léna Jabre. La décision date du 4 juillet 2025 et concerne l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur le terrain d’un particulier. Les réactions révèlent une confusion conceptuelle majeure qui n’est pas sans refléter des causes des blocages concernant les recours à la médiation.
Les acteurs cités dans l’article :
- Alexandre Ciaudo : avocat spécialisé en droit de l’urbanisme et droit des marchés publics
- Amaury Lenoir : chargé de médiation au tribunal administratif de Nice, délégué national à la médiation pour les juridictions administratives
- Amandine Domingues : Avocate & Médiatrice au barreau du Havre – Droit public
- Le juge du tribunal administratif de Dijon (par sa décision)
Les faits selon la décision du TA
Le tribunal administratif de Dijon statue sur :
- L’annulation d’un arrêté d’opposition à une antenne-relais
- Un protocole transactionnel signé entre les parties
- La demande de la commune de constater le désistement des requérants
- Le refus des requérants de se désister (difficultés avec les propriétaires du terrain)
La décision ne fait aucune mention d’une médiation et ne fonde aucun argument sur le processus quel qu’il soit. Elle ne traite que du résultat : le protocole transactionnel et ses effets juridiques (art. 2044 Code civil).
Ainsi, l’article consiste à proposer la lecture de commentaires sur un processus hypothétique (médiation supposée) avec le résultat (transaction avérée) où des commentateurs débattent de quelque chose qui n’est pas dans le jugement.
Les réactions révélatrices d’une confusion conceptuelle
Alexandre Ciaudo déclare : « si après des mois de médiation et de laborieuses réunions, outre échanges multiples sur le sens d’un protocole transactionnel… », sans que l’on sache si en fait il s’agit d’une pratique de négociation assistée par un tiers, de discussions plus ou moins informelles, de recours épisodique à de l’arbitrage avorté, de la conciliation jouant sur des conseils au regard d’enjeux temporels, économiques ou autres. Par contre, il identifie que les propriétaires n’étaient pas dans les discussions, au moins pour l’usage de leur propriété, ce qui n’a pas été sans conséquence. Claudio précise : « Ni le promoteur ni le médiateur ne les ont invités à participer à la médiation ».
Ici, déjà, s’il y a eu médiation préalable à l’action judiciaire, en présence d’un médiateur, la question peut se poser de sa responsabilité professionnelle compte tenu du fait qu’il n’a pas su affirmer la nécessité d’avoir autour de la table les décisionnaires concernant l’usage du bien concerné.
Application d’une grille inadéquate
Amaury Lenoir développe : « le processus de médiation, même lorsqu’il est ordonné par le TA, n’est pas contraint… il est ainsi possible… de faire participer des tiers au processus de médiation engagé »
- Il présuppose un processus de médiation que rien n’indique dans la décision visée
- Il donne des conseils sur une médiation hypothétique
- Sa position institutionnelle rend cette extrapolation d’autant plus dommageable
Si il y avait eu médiation, A. Lenoir aurait raison : l’absence des propriétaires du terrain la rendait très illusoire dès le départ. Mais les propriétaires ne sont pas des tiers : ils sont des parties directes dans l’affaire ; n’en déplaise à tout autre, c’est de leur propriété dont il est question aussi.
Résoudre un différend sur l’usage d’un terrain sans impliquer ses propriétaires, c’est comme de vendre un bien à quelqu’un qui ne l’a pas demandé. Dans tous les cas, cette analyse technique peut bien être pertinente, elle porte sur un processus non établi.
A retenir pour connaître la médiation et y recourir
- Une transaction (résultat) peut échouer quelle que soit la qualité du processus qui y a mené (médiation, négociation directe, etc.) si elle est mal conçue – en l’occurrence sans associer les propriétaires du terrain.
- Le juge n’est pas responsable des défauts de conception d’un accord, qu’il résulte d’une médiation défaillante ou de toute autre forme de négociation. Il applique le droit sur ce qui lui est soumis.
- Cette affaire enseigne surtout de ne pas extrapoler au-delà des faits établis et de bien identifier toutes les parties prenantes avant tout accord, quel que soit le processus utilisé.
Le recours à l’expertise professionnelle de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation aurait permis d’éviter cette polémique artificielle et de recentrer le débat sur les vraies questions : comment bien concevoir un accord transactionnel et identifier toutes les parties prenantes nécessaires.
Cette affaire enseigne l’importance de s’appuyer sur l’expertise reconnue avant de commenter des sujets techniques et de ne pas extrapoler au-delà des faits établis.
Sources :
- https://dijon.tribunal-administratif.fr/ TA de Dijon, 4 juillet 2025, req. n°2300272 (Avant de parler médiation, lisez le jugement.)
- Gazette des Commune, 10 juillet 2025 https://www.lagazettedescommunes.com/993805/la-mediation-dans-la-tourmente/
- Code d’éthique et de déontologie de la médiation professionnelle – www.cpmn.info
- Formation des médiateurs professionnels www.epmn.fr




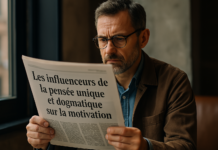

![Livre [nouveauté] : Médiations en milieux hostiles](https://www.officieldelamediation.fr/wp-content/uploads/2023/10/Médiations-en-milieux-hostiles-218x150.png)