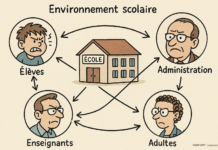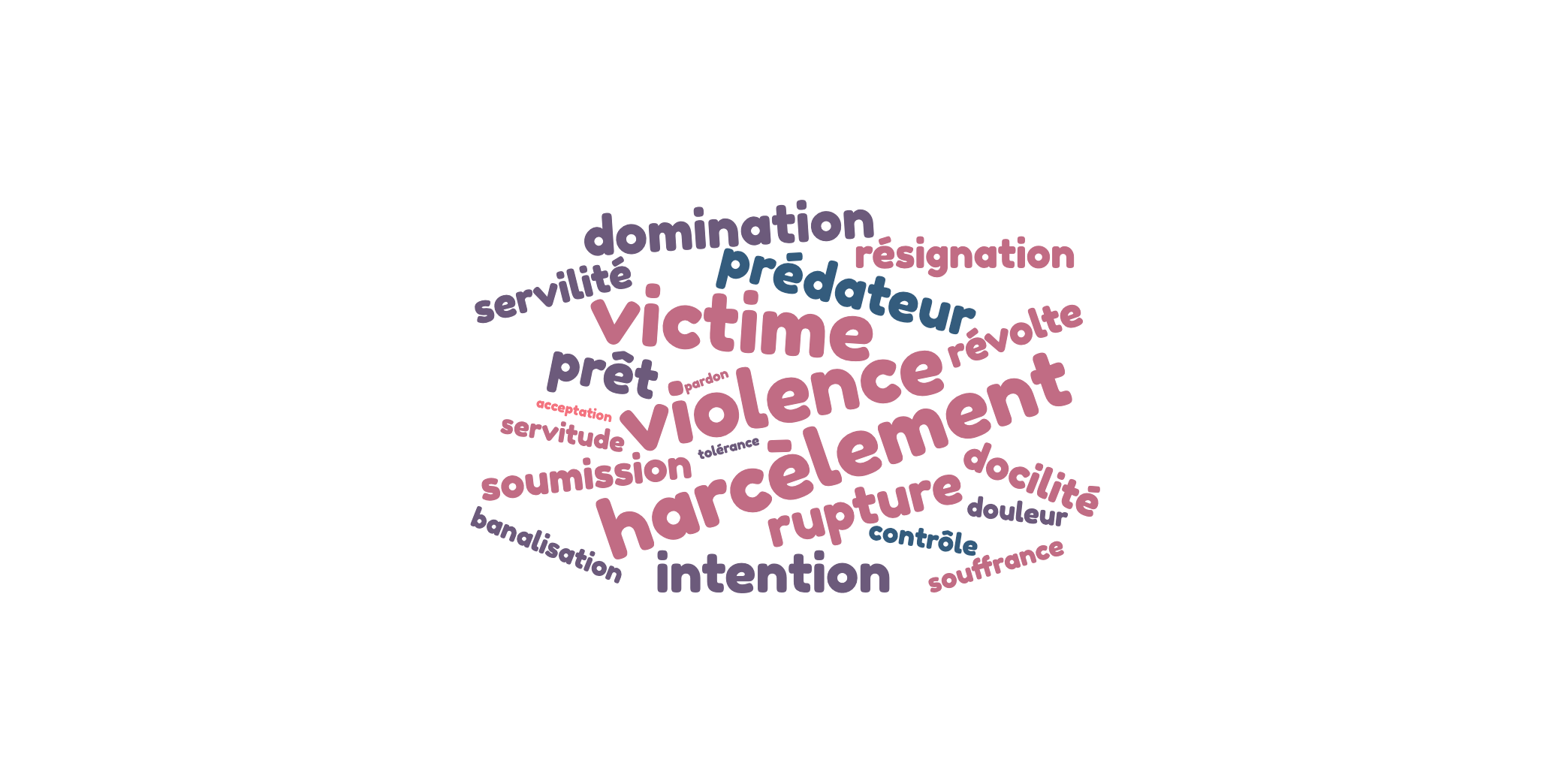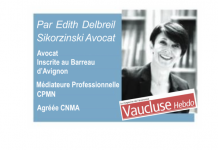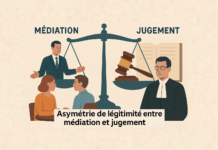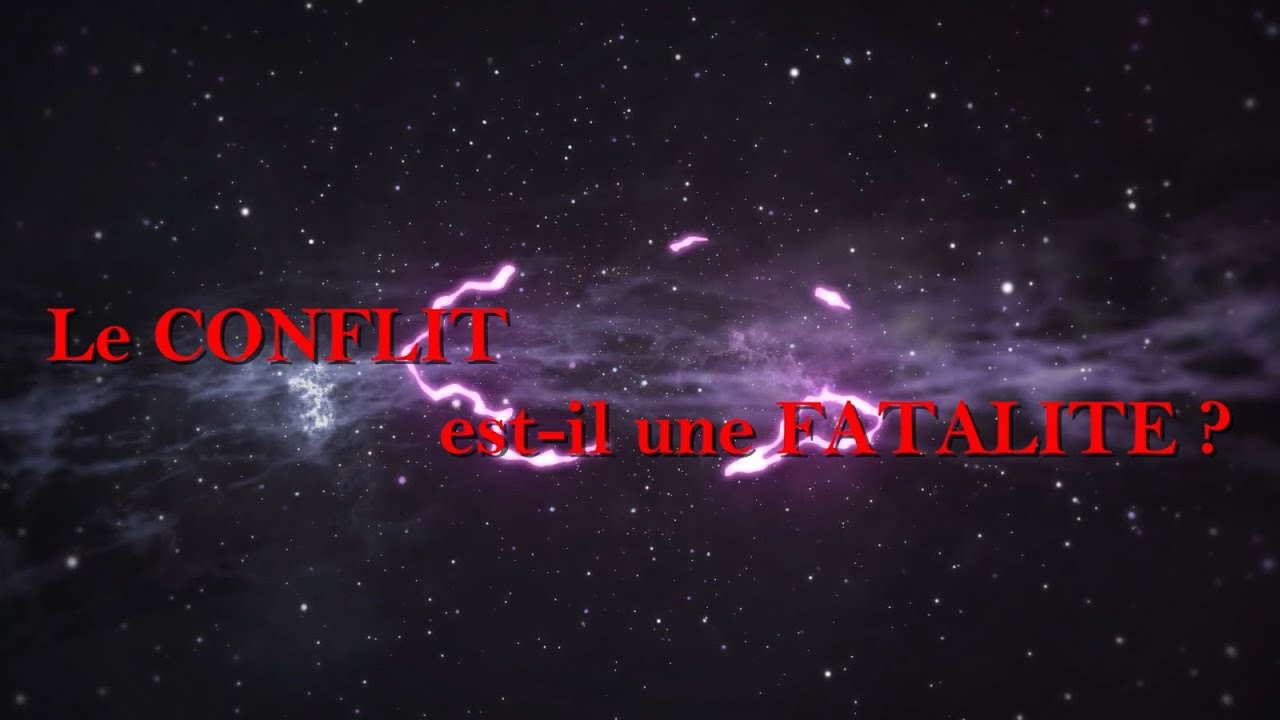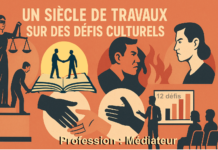1. Présentation
Une organisation internationale de médiation est née le 30 mai 2025, à l’initiative de la Chine. Cette initiative est alignée sur un vide Onusien. L’idée d’une organisation internationale dédiée à la médiation remonte à près d’un siècle, à l’époque de la Société des Nations. En 1925, Jean Efremoff (Ivan Nikolaïevitch Efremov), publie un traité intitulé La médiation et la conciliation internationale, où il propose une organisation dotée de règles, de procédures, de neutralité institutionnelle et de panels de médiateurs. Les deux guerres mondiales du monde occidental passées, le sociologue français Gaston Bouthoul (1896–1980) fonde la polémologie. Il publie une série d’analyses sur les causes structurelles des conflits armés et appelle à une éducation à la paix et à la création d’institutions de prévention — notamment dans la collection Médiations chez Denoël. Ses travaux, à la croisée du droit international et de la diplomatie parlementaire, ont inspiré de nombreuses initiatives en matière de règlement pacifique des différends.
L’Organisation internationale pour la médiation concrétise pour la première fois cette vision fondatrice en lui donnant une base institutionnelle multilatérale effective. Elle est implantée à Hong Kong avec plusieurs représentants d’États (32 pays adhérents fondateurs) souhaitant promouvoir une approche non juridictionnelle du règlement des différends internationaux. Elle constitue la première structure intergouvernementale spécifiquement conçue pour offrir des services de médiation couvrant les différends interétatiques, les conflits entre États et ressortissants étrangers, ainsi que les litiges commerciaux internationaux entre parties privées.
L’OIMed s’inscrit dans le cadre de l’article 33 de la Charte des Nations Unies. Elle propose une alternative consensuelle, confidentielle et flexible aux modes classiques de règlement des différends, dans un contexte marqué par la recherche croissante d’un multilatéralisme inclusif et opérationnel.
2. Base juridique
Pour les aspects relationnels, voir plus bas la proposition de formation des médiateurs.
- L’OIMed est instituée par la Convention sur l’établissement de l’Organisation internationale pour la médiation (convention OIMED en français), qui comporte 63 articles.
- La Convention entre en vigueur 30 jours après le dépôt du troisième instrument de ratification.
- L’OIMed a personnalité juridique internationale (article 6).
- Elle bénéficie d’immunités et privilèges pour ses biens, agents et locaux (chapitre X).
3. Objectifs et fonctions
- Fournir des services de médiation sur consentement mutuel pour :
- les différends entre États eux-mêmes ;
- les différends entre un État et un ressortissant d’un autre État. Elle affirme le respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de la non-ingérence et de l’état de droit international (article 4).
- promouvoir la culture de la médiation, organiser des conférences, renforcer les capacités institutionnelles (article 5).
- les différends commerciaux internationaux entre parties privées (articles 24 à 28).
4. Organisation interne
a) Conseil des gouvernements (chapitre II)
- Un représentant par État membre.
- Rôle : élaboration des politiques, adoption des règlements internes, supervision.
b) Secrétariat (chapitre III)
- Dirigé par un Secrétaire général.
- Assure l’exécution des décisions du Conseil.
c) Panels de médiateurs (articles 19 à 23)
- Deux panels :
- Médiateurs État-État ;
- Panel général (État-personne et personne-personne).
- Chaque État membre peut désigner :
- jusqu’à 5 médiateurs État-État ;
- jusqu’à 20 médiateurs pour le panel général, ou 30 pour les membres fondateurs.
- Le Conseil peut désigner des médiateurs supplémentaires (jusqu’à 10 + 20).
- Critères : compétence, intégrité morale, expertise juridique, diplomatique ou économique (article 21).
- Mandat : 5 ans renouvelable.
5. Adhésion
- La Convention est ouverte à tous les États et aux organisations d’intégration régionale (articles 57 à 59).
- Des déclarations d’exclusion sont possibles pour certains types de contentieux (article 29).
6. États adhérents et signataires
a) États signataires de la Convention (33 États fondateurs) :
Algérie, Biélorussie, Bénin, Cambodge, Cameroun, Chine, Congo, Cuba, Djibouti, Dominique, Guinée équatoriale, Éthiopie, Gabon, Guinée-Bissau, Indonésie, Jamaïque, Kenya, Kiribati, Laos, Mauritanie, Nauru, Nicaragua, Nigéria, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Serbie, Îles Salomon, Soudan, Timor oriental, Ouganda, Vanuatu, Venezuela, Zimbabwe.
b) États signataires de la Déclaration conjointe préparatoire (non exhaustive, plus de 80 pays) :
Algérie, Biélorussie, Cambodge, Cameroun, Chine, Côte d’Ivoire, Djibouti, Guinée équatoriale, Éthiopie, Gabon, Indonésie, Laos, Madagascar, Pakistan, Serbie, Sri Lanka, Soudan, Thaïlande, Zimbabwe.
c) États présents à la cérémonie du 30 mai 2025 (non signataires mais participants) :
Environ 50 pays supplémentaires : la liste exhaustive des États présents n’a pas été rendue publique à ce jour.
7. Organisations apparentées ou concurrentes
- Non juridictionnelle : ne concurrence pas la CIJ ou le CIRDI.
- Complémentaire mais potentiellement concurrente des institutions d’arbitrage commercial international telles que :
- SIAC (Singapore International Arbitration Centre) : https://www.siac.org.sg ;
- LCIA (London Court of International Arbitration) : https://www.lcia.org.
8. Règles de médiation (articles 30 à 35)
- Principes fondamentaux : volontariat, impartialité, indépendance, bonne foi, efficacité, économie.
- Code de conduite des médiateurs : à venir, fondé sur l’obligation de divulguer les conflits d’intérêts, équité entre parties, interdiction de cumul (article 35).
- Confidentialité assurée (article 33).
- Les propos échangés en médiation sont inopposables dans toute autre procédure (article 34).
9. Accords de règlement (articles 39 à 41)
- Les accords issus d’une médiation OIMed doivent être authentifiés par le Secrétaire général.
- Ils sont contraignants, mais ne constituent pas une reconnaissance du droit applicable.
- Un protocole d’exécution est en cours d’élaboration pour les accords entre parties privées.
10. Domaines exclus du champ d’intervention de l’OIMed
Malgré son champ d’action étendu, l’OIMed n’a pas vocation à traiter certains types de différends, soit en raison de leur nature, soit parce qu’ils relèvent d’autres juridictions spécialisées, notamment :
| Domaines exclus | Motif ou observation |
| Litiges civils entre personnes physiques (hors commerce) | Non couverts sauf lien direct avec une relation commerciale internationale (art. 28). |
| Conflits armés internes / guerres civiles | L’OIMed ne traite pas les différends intra-étatiques, sauf clause conjointe explicite. |
| Droit pénal international (crimes, responsabilités) | Relève de la CPI ou de juridictions spécialisées. |
| Violations des droits de l’homme | En dehors du mandat OIMed, sauf si intégrées à un différend contractuel plus large. |
| Litiges de travail (employeur–salarié) | Compétence des juridictions sociales ou de l’OIT ; hors champ OIMed. |
| Litiges de consommation | Transactions personnelles ou domestiques expressément exclues par l’article 28. |
| Litiges de droit administratif | Actes unilatéraux d’un État envers ses administrés ou étrangers, hors champ contractuel. |
| Différends relevant d’organismes spécialisés (OMC, CIRDI, etc.) | Régis par des procédures contraignantes existantes. |
| Absence de consentement mutuel des parties | L’OIMed repose exclusivement sur la volonté libre et conjointe des parties. |
11. Défis prospectifs
L’OIMed devra relever plusieurs défis structurants pour s’imposer durablement dans le paysage international du règlement des différends. L’absence d’adhésion initiale de la majorité des grandes puissances occidentales pourrait limiter son influence normative à court terme, bien que son modèle attire progressivement un nombre croissant d’États issus du Sud global. L’effectivité des accords de médiation reposera sur la mise en place de dispositifs incitatifs ou de reconnaissance mutuelle, la médiation n’impliquant pas d’obligation exécutoire par défaut. L’enjeu de la représentativité géopolitique, notamment en matière de diversité des médiateurs et d’équilibre des désignations, influencera la légitimité institutionnelle à mesure que de nouveaux membres rejoindront la Convention. Enfin, si le choix de Hong Kong comme siège opérationnel confère des avantages logistiques et juridiques indéniables, il soulève également des interrogations sur la perception d’indépendance. Une gouvernance transparente, une répartition équilibrée des responsabilités, et l’ouverture à des observateurs tiers renforceront la crédibilité de l’organisation à moyen terme.
12. Formation des médiateurs : un angle mort stratégique
Le dispositif de l’OIMed, bien que rigoureusement établi sur le plan juridique et institutionnel, ne traite pas explicitement de la formation méthodologique des médiateurs. Or, si la compétence procédurale parait être essentielle, c’est dans le modèle juridique avec ses ancrages dans la dispute, c’est les compétences relationnelles que la grande partie des différends se jouent et que l’on peut puiser les conditions fondamentales de l’efficacité de toutes les formes de médiations, a fortiori internationales.
Absence de dispositif de formation harmonisé
Les articles 21 et 35 de la Convention mentionnent des critères généraux : compétence, intégrité morale, expertise juridique, diplomatique ou économique. Mais ils n’impliquent ni tronc commun de formation, ni certification, ni référentiel opérationnel partagé, capable de garantir une lecture systémique des différends internationaux.
Risque de confusion entre structure et circonstance
Dans les différends internationaux, une erreur récurrente consiste à confondre :
- des intérêts géopolitiques structurels (ressources, frontières, asymétries systémiques),
- des conflits politiques circonstanciels (stratégies de dirigeants, nationalismes, diversions internes),
- des enjeux symboliques ou idéologiques instrumentalisés,
- des diplomaties indirectes (tiers invisibles, alliances masquées).
Sans formation spécifique, un médiateur peut calquer des schémas techniques sur des différends qui requièrent une lecture à plusieurs niveaux (structurel, conjoncturel, comportemental).
Conséquence stratégique : vers une nouvelle professionnalisation
Une médiation assurée par des profils simplement « juridiques » ou « diplomatiques » peut rester enfermée dans des logiques classiques, inopérantes ou manipulables.
L’efficacité réelle de l’OIMed dépendra de sa capacité à :
- professionnaliser une génération de médiateurs internationaux transdisciplinaires ;
- outiller ces médiateurs pour ajuster leur intervention selon la nature profonde du différend ;
- garantir des résultats durables, systémiquement ajustés, et non conjoncturellement utiles.
Un programme de formation est indispensable. Il doit intégrer la lecture multi-niveaux, la régulation symbolique, la détection des fausses causalités et la proposition de solutions non instrumentalisables.
Sans cela, l’OIMed risque de produire des accords éphémères, instrumentalisés ou dénués d’efficience politique. Ce manque constitue à ce jour le principal point faible stratégique de l’institution.
Voici les pistes proposées par l’école professionnelle de la médiation et de la négociation (25 ans d’expérience) :
Contenus fondamentaux :
| Contenus | fondamentaux : |
| Domaine | Objectifs |
| Géopolitique systémique | Lire les causes profondes des différends : ressources, asymétries historiques, réseaux d’influence |
| Représentation du pouvoir et relations aux rapports d’autorité | Identifier les stratégies d’influence, d’évitement ou de manipulation des dirigeants. Appropriation des biais cognitifs, notamment la confusion identitaire. |
| Cartographie relationnelle multi-niveaux | Distinguer les intérêts des États, des peuples, des élites, des dirigeants |
| Éthique de l’indépendance, de l’impartialité et de la neutralité | Résister à l’alignement passif, maintenir l’ajustement entre les parties malgré les pressions, préserver une posture distanciée, hors des référentiels circonstanciels de morale, de droit et des représentations normatives. |
| Stratégies de médiation (professionnelle) non-linéaire | Adopter une posture ajustative : ni arbitrale, ni conciliatrice par défaut, mais méthodologique. Savoir inciter les implications dans la médiation, créer les motivations et les entretenir |
| Évaluation des issues durables | Savoir identifier les ententes viables sur le long terme au-delà des cycles politiques, en démêlant les issues vraisemblables, les engagements opportunistes et l’entente réelle. |
Conclusion
L’OIMed incarne une initiative institutionnelle inédite dans l’histoire du règlement pacifique des différends internationaux. En proposant un cadre structuré, multilatéral et non juridictionnel, elle ouvre un espace distinct des juridictions classiques, fondé sur la médiation volontaire, la confidentialité et la souplesse procédurale.
Sa légitimité repose toutefois sur plusieurs conditions : élargissement géopolitique, reconnaissance mutuelle des accords, indépendance effective des médiateurs, et professionnalisation méthodique des intervenants. À ce titre, la question de la formation constitue un levier stratégique encore sous-développé, mais indispensable à l’émergence d’une profession de médiateur international à part entière.
Si l’OIMed parvient à relever ces défis, elle pourra durablement s’imposer comme un acteur de référence dans l’architecture de la gouvernance internationale, au service d’un multilatéralisme opérationnel et ajustatif.
Notes historiques : de La Haye à l’OIMed
Quoique l’initiative ne semble pas avoir une inspiration associée directement avec les recherches et initiatives historiques occidentales, hormis la référence à l’article 33 de la Charte des Nations Unies, il est intéressant d’indiquer que l’idée de la médiation internationale entre Etats a un écho très fort dans des volontés répétées jusqu’à ce jour restées sans effet. Pour remonter plus loin qu’au 19ème siècle, vous pouvez vous reporter à l’article sur Wikipedia concernant la médiation politique. Voir aussi l’article Wikipédia : Histoire de la médiation – section médiation politique.
📜 Frise chronologique des jalons de la médiation internationale
- 1899 – Conférence de La Haye : reconnaissance du recours volontaire à la médiation pour prévenir les conflits armés.
- 1907 – Deuxième conférence de La Haye : confirmation du rôle des États tiers médiateurs et élargissement des procédures pacifiques.
- 1925 – Proposition Efremoff : Jean Efremoff publie un projet d’organisation internationale de médiation et de conciliation structurée (publication en lien avec le Congrès mondial de la paix).
- 1945 – Charte des Nations Unies, article 33 : codifie la médiation comme moyen reconnu de règlement pacifique des différends.
- 1980s–2020s – Multiplication des centres de médiation privés et institutionnels (CCI, SIAC, LCIA, CIRDI).
- 2019 – Convention de Singapour sur la médiation : première norme internationale sur l’exécution transfrontalière des accords issus de médiation.
- 2025 – Création de l’OIMed : première organisation intergouvernementale universelle exclusivement dédiée à la médiation internationale.
Sources principales et annexes
- Site officiel : https://www.international-mediation.org/
- Convention: https://www.international-mediation.org/basic-documents/#convention
- Adresse : Hong Kong, dans un bâtiment historique de 4 étages (ancien commissariat de Wan Chai), d’une superficie de 5000 m².
- https://www.cms-lawnow.com
- https://www.brookings.edu
- https://www.international-mediation.org
- Herbert Smith Freehills Kramer LLP, Antony Crockett, Martin Wallace et Joris Bertrand, “The International Organization for Mediation: a new intergovernmental organisation for the resolution of international disputes through mediation”, 9 juillet 2025. https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=dd648a22-c538-4b4e-97b0-6382cd820d91
- Une synthèse historique complémentaire est disponible en ligne : « Histoire de la médiation » – Wikipédia.
- Ecole Professionnelle de la Médiation et de la négociation – epmn.fr
Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation – cpmn.info
____
Article 33 Charte des Nations Unis
- Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.
- Le Conseil de sécurité, s’il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens.




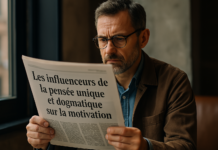

![Livre [nouveauté] : Médiations en milieux hostiles](https://www.officieldelamediation.fr/wp-content/uploads/2023/10/Médiations-en-milieux-hostiles-218x150.png)