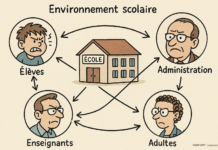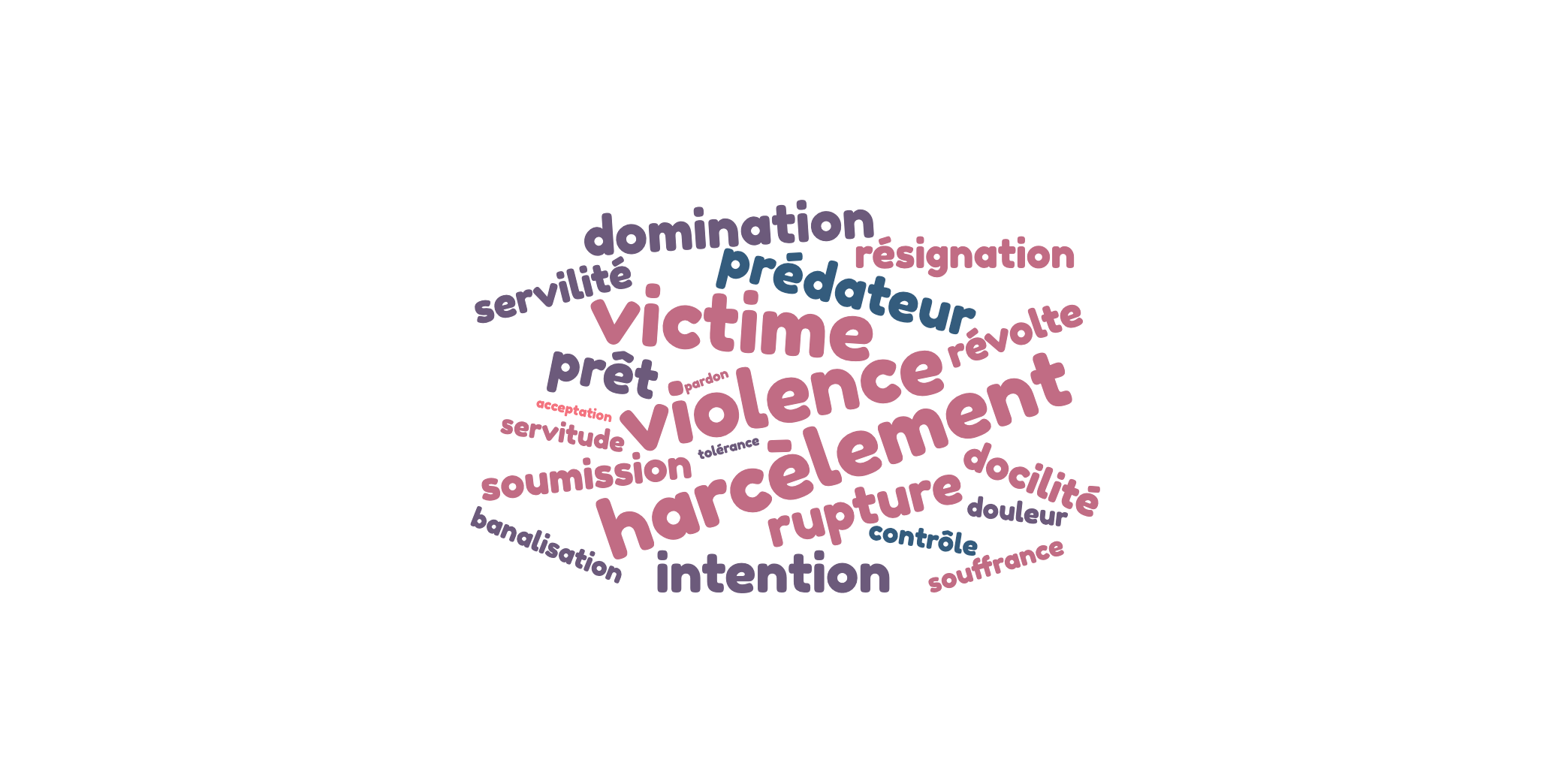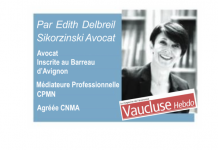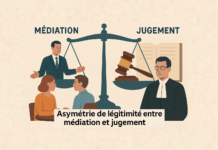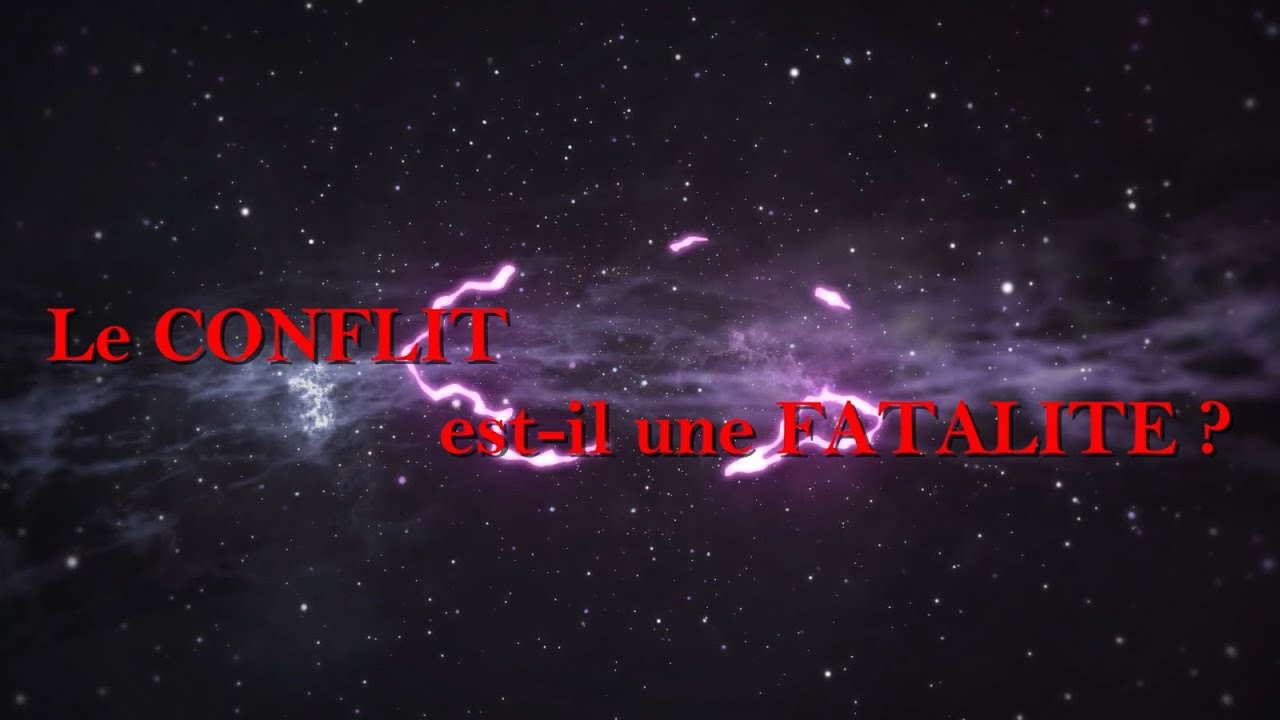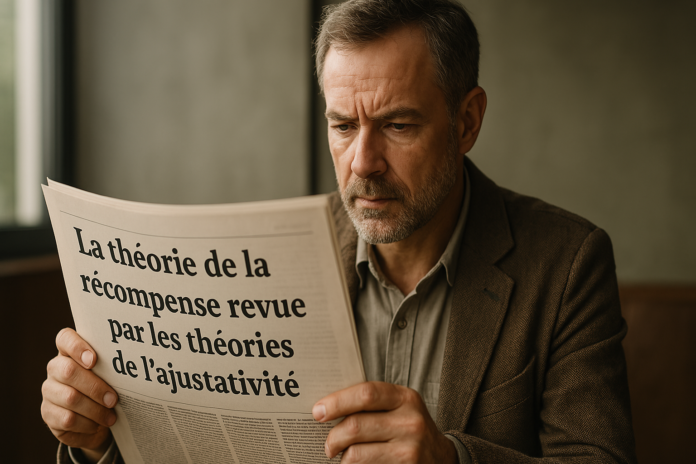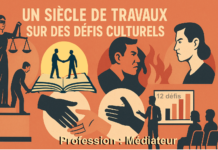Cet inventaire des théories, d’affirmations dogmatiques, de prétentions scientifiques, d’observations sous prismes culturels invisibles – solidement ancrée par l’histoire et les croyances collectives – c’est-à-dire sous biais de la pensée, travers de la réflexion,montre l’impérieuse nécessité de revisiter prudemment ce qui fonde la motivation humaine, parce que c’est l’idée de ce qui nous fait et aussi c’est celle que nous transmettons en héritage.
A la limite, peu importe l’héritage à transmettre, voyons déjà seulement les conséquences contemporaines sur les déséquilibres, les discriminations, les conceptions élitistes, les injustices et les mépris.
L’idée même que l’être humain (et par extension, le vivant) agirait principalement en fonction d’une quête de gratification repose sur des présupposés. Le conditionnement pavlovien, le renforcement skinnérien, la motivation par la gratification de Herzberg, ou encore les systèmes dopaminergiques de la récompense étudiés par Schultz et Berridge, participent tous à un même paradigme : celui d’un cerveau conçu pour maximiser le gain et minimiser la perte ; Karl Friston l’a aussi bien intégré. Pourtant, cette hypothèse souffre d’un biais de temporalité contextuelle : elle émerge et s’épanouit dans une époque où l’économie de marché, la gestion des performances et l’optimisation des ressources deviennent des modèles dominants, lesquels – par rétropensées et généralisations probabilistes – façonnent notre manière de concevoir le comportement humain.
Pourtant, plusieurs éléments viennent déconstruire cette idée. Prêt pour la “revisite” ? :
- Le cerveau n’est pas une machine à prédire, mais un organisateur du présent
Lorsqu’un individu prend une décision, il ne le fait pas en calculant rationnellement les récompenses à venir, mais en croisant ses expériences passées avec la situation immédiate. Il ajuste son action en fonction de la satisfaction qu’il peut éprouver à partir de l’harmonie perçue entre son vécu et l’équilibre avec son environnement. - La notion de récompense repose sur un anthropocentrisme gestionnaire
La dopamine est souvent considérée comme le neurotransmetteur de la récompense. Pourtant, les recherches récentes montrent qu’elle joue un rôle bien plus large dans la modulation des comportements et l’adaptation aux situations nouvelles. La réduire à un simple médiateur de la gratification est un biais conceptuel issu d’une approche trop focalisée sur la récompense. - L’effet de satisfaction n’est pas une finalité, mais un état transitoire
Dans le modèle de la TCC-HA, la loi de la satisfaction joue un rôle central. Contrairement à la vision traditionnelle qui assimile la satisfaction à une récompense obtenue après un effort, la TCC-HA propose que la satisfaction est un processus homéostatique : elle se manifeste lorsque le cerveau atteint un état d’ajustement optimal dans son rapport au monde, indépendamment d’une récompense matérielle ou sociale. - La récompense est une construction culturelle, non une nécessité biologique
Les religions, les philosophies et les sciences comportementales ont souvent présenté la motivation humaine comme une quête de gratification : paradis promis, félicité spirituelle, reconnaissance sociale, succès matériel. Mais ces notions sont des élaborations culturelles, et non des nécessités biologiques. La TCC-HA remet en question cette vision en démontrant que le cerveau ajuste ses comportements selon des corrélations immédiates, et non en fonction d’une promesse lointaine de plaisir. - Enfin, s’il en est besoin, la totalité des interventions en médiation professionnelle conduite avec une méthodologie rigoureuse, a montré que les personnes ne résolvent pas leurs différends en privilégiant des enjeux et des intérêts, mais en recherchant l’ajustement relationnel, soit en donnant à la qualité relationnelle une préférence qui ne récompense pas, mais qui harmonise en soi, équilibre relationnellement et apporte durablement la meilleure des satisfactions possible, considérée au moment présent.
La récompense : l’héritage d’une pensée projective ?
Cette critique s’inscrit dans une remise en question plus large des modèles fondés sur la prévision. La théorie du cerveau prédictif, qui postule que notre cerveau fonctionne en minimisant l’incertitude et en anticipant les erreurs, repose sur une même logique gestionnaire que celle des théories de la récompense. Or, la Théorie du Cerveau Corrélatif et de l’Harmonisation Ajustative – TCC-HA propose une alternative radicale : le cerveau ne cherche pas à prédire, mais à organiser, structurer, corréler le présent.
Dans cette perspective, la motivation humaine ne serait pas une quête d’un futur meilleur, mais une dynamique d’ajustement permanent. Il ne s’agit plus de considérer que nous agissons pour obtenir une récompense, mais bien que nous agissons pour maintenir une harmonie immédiate dans nos représentations et nos interactions.
Conséquences sur la compréhension du comportement humain
- Nos choix ne sont pas dictés par des projections futures, mais par des ajustements immédiats.
- La notion de gratification comme moteur de l’apprentissage est surestimée.
- Les biais cognitifs ne résultent pas de mauvaises anticipations, mais d’une mauvaise corrélation des expériences passées avec les situations présentes.
- Les enseignements et la formation continue devraient moins se focaliser sur la récompense et la punition, et davantage sur l’ajustement dynamique des comportements en fonction des contextes et des besoins réels.
Une révision épistémologique nécessaire
La théorie de la récompense, si dominante soit-elle, pourrait bien être l’une des plus grandes illusions de notre époque. En la replaçant dans son contexte historique et culturel, et en la confrontant aux découvertes les plus récentes sur le fonctionnement du cerveau, la TCC-HA ouvre une perspective quelque peu révolutionnaire : l’humain ne cherche pas la gratification, il ajuste son action au moment présent.
L’idée de la récompense semble fonctionner parce qu’en fait elle est précédée de l’état de satisfaction immédiat ; si ce n’est pas le cas, la récompense n’attire pas.
Ainsi, cela ne signifie pas que la notion de récompense soit totalement invalide, mais qu’elle est une conséquence et non une cause du comportement. En d’autres termes, ce que nous percevons comme une récompense n’est pas un but recherché, mais un état temporaire d’ajustement neuronal, qui disparaît aussi vite qu’il est atteint.
Si l’avenir des sciences cognitives est de mieux comprendre le fonctionnement humain, alors il est temps d’envisager un changement de paradigme.
À l’issue de ce parcours critique, un constat s’impose : la théorie de la récompense, aussi séduisante soit-elle, repose sur une série de postulats historiquement situés, culturellement renforcés et cognitivement biaisés. Cette théorie s’inscrit dans un modèle gestionnaire du vivant, hérité d’une pensée religieuse, prolongée par une scientifisation des rapports de domination et de la prédictivité. En cela, elle constitue non une vérité du fonctionnement humain, mais une construction idéologique cohérente avec son époque. Et peut-être est-ce là, le plus grand des renversements de la théorie du cerveau corrélatif et de l’harmonisation ajustative – TCC-HA : Non, l’humain n’est pas un chercheur de récompense, ni un esclave de la quête de récompense, mais un artisan de la régulation de l’instant.
Il reste à suivre des contributions très concrètes du nouveau corpus théorique. N’hésitez pas à partager, à questionner, à contribuer.
La série :
- Tentation, récompense et prédictivité : mythe religieux, fiction socio-économique et biais cognitif de la motivation 1/3 (10 avril)
- Les influenceurs de la pensée unique et dogmatique sur la motivation 2/3 (11 avril)
- La théorie de la motivation par la récompense revue par les théories de l’ajustativité 3/3 (12 avril)




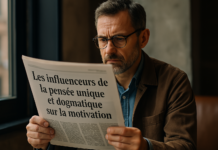

![Livre [nouveauté] : Médiations en milieux hostiles](https://www.officieldelamediation.fr/wp-content/uploads/2023/10/Médiations-en-milieux-hostiles-218x150.png)