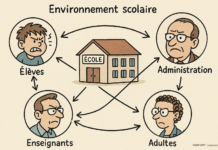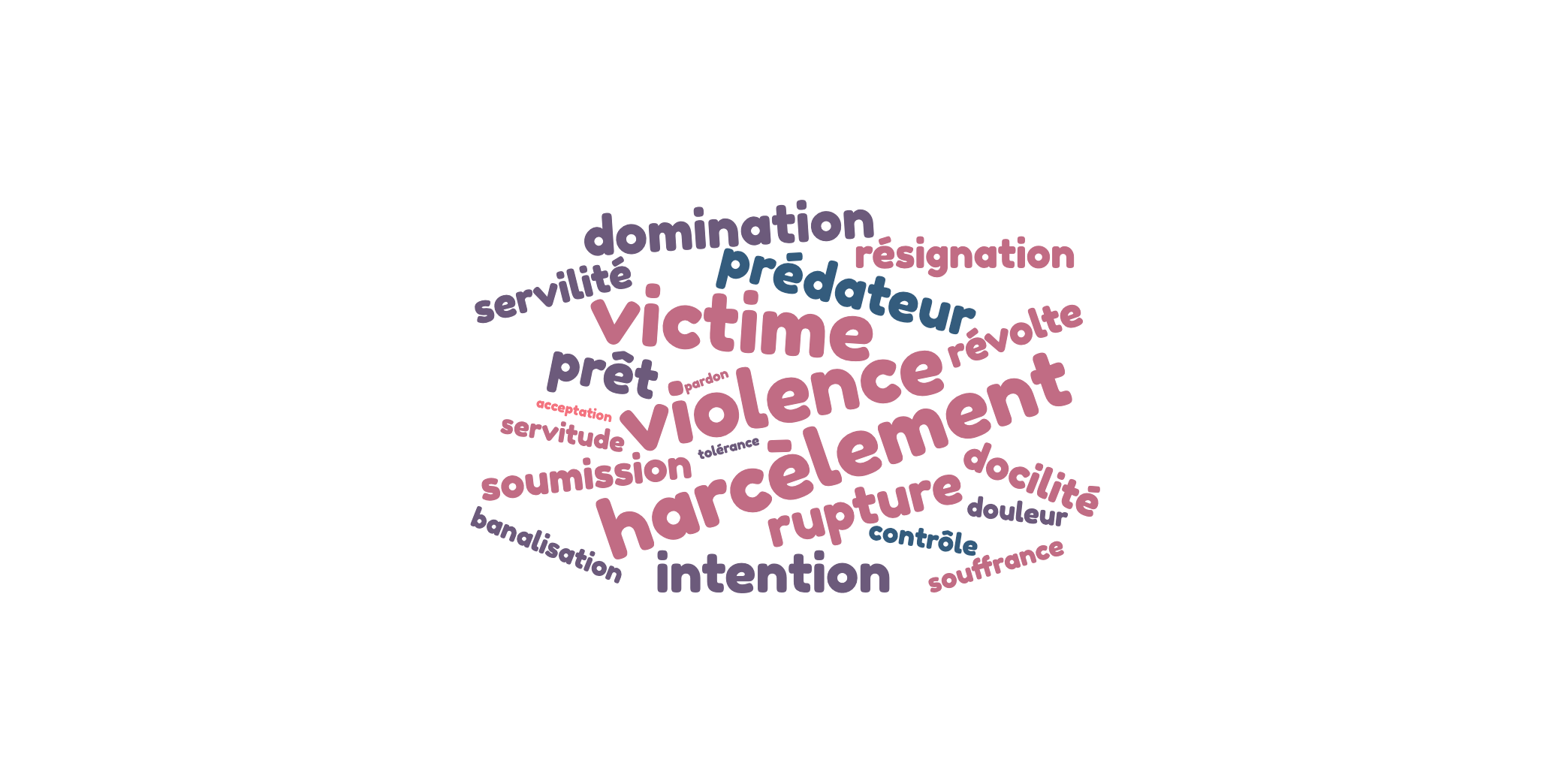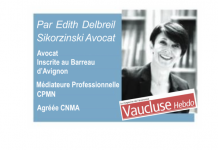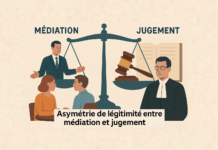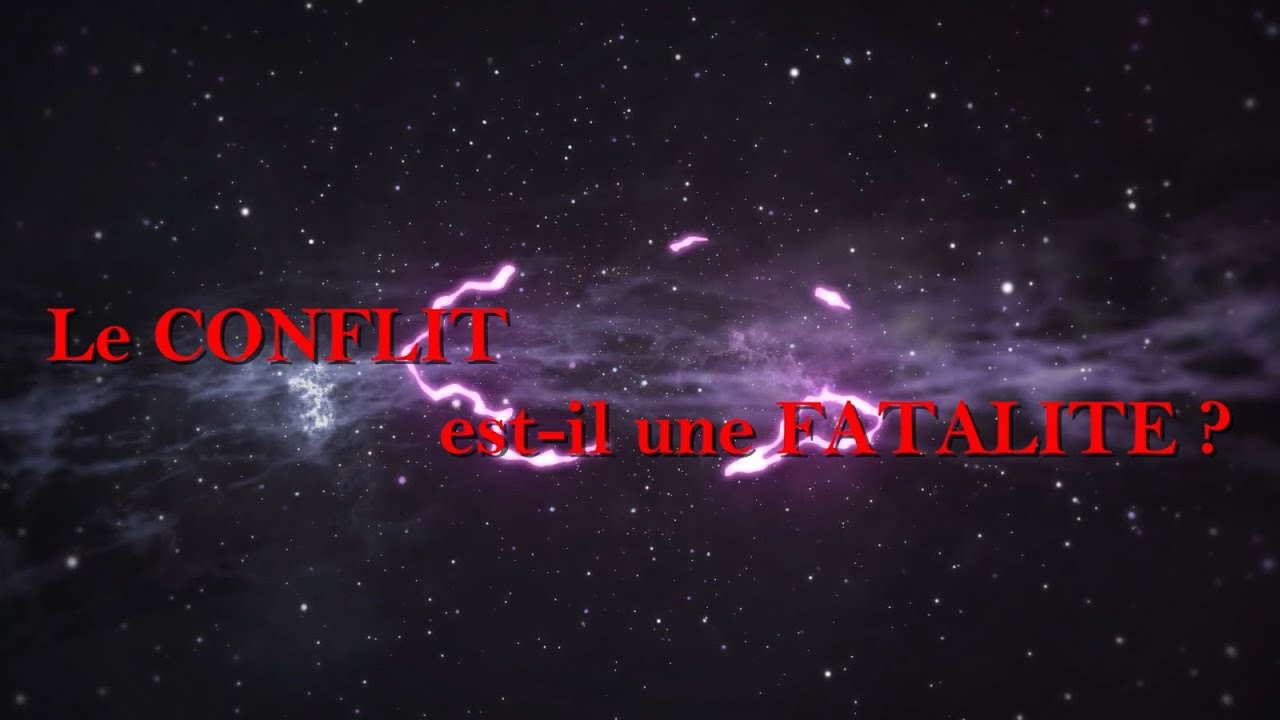une illusion de la rentabilité, un biais culturel à dépasser
Une évidence à interroger
Qui n’a jamais entendu l’expression « gagnant-gagnant » comme solution idéale à un conflit ou à une négociation ? Elle semble si évidente, si naturelle, qu’elle est devenue un réflexe de langage, une promesse automatique. Pourtant, derrière cette formule se cache un biais culturel puissant, produit par l’époque et par un environnement socio-économique obsédé par la rentabilité. Dans une société où tout se mesure en termes de profit, on en vient à vendre l’eau, et certains seraient prêts à vendre l’air que l’on respire et à mettre des péages dans les files d’attente, en trouvant encore les arguments d’un « gagnant-gagnant ». Cette logique révèle moins une sagesse universelle qu’un biais de temporalité contextuelle : celui d’une culture spéculative qui impose l’idée que toute relation doit être conçue comme un marché équilibré.
1. Origines : la culture de l’adversité
Le « gagnant-gagnant » n’est pas né d’une culture de coopération, mais d’une anthropologie du conflit. Depuis l’Antiquité, la formule « homo homini lupus » (Plaute – Asinaria), dont la cause de l’ignorance était clairement identifiée, a été reprise de manière simplifiée et simplificatrice par Hobbes (Le citoyen – 1642) et illustre cette vision : l’homme serait naturellement adversaire de l’homme. Dans ce cadre, les rapports humains sont vus comme des jeux de prédation : ce que l’un gagne, l’autre le perd. Cette pensée a fondé l’idéologie moderne de la compétition généralisée.
2. Formalisation moderne : du jeu à la matrice
Au XXᵉ siècle, la théorie des jeux (Von Neumann & Morgenstern, 1944) formalise les interactions en matrices binaires : gagnant-perdant, perdant-gagnant, perdant-perdant, gagnant-gagnant. Ce n’est pas de la logique, c’est de l’analogie : des rapports flous entre équivalences et similitudes qui jouent sur les représentations, les consonances et les raisonnements à l’arrache. Cette schématisation séduit par sa simplicité, mais elle est réductrice : elle ignore les asymétries de positionnement, de motivation et de pouvoir ; elle ignore les tiers exclus et la temporalité des pertes différées. L’apparente rationalité masque une pensée toujours centrée sur la gestion des rapports de force, même quand elle se présente comme coopérative. C’est le monde du deal : on échange un bien contre un injuste, un mauvais contre un normal et on prétend y trouver des équilibres et une équité acceptable.
3. Adoption du paradigme « win-win »
Dans les années 1980, le concept est popularisé par Roger Fisher et William Ury (Getting to Yes, 1981). Leur méthode de négociation raisonnée est associée à l’image de Harvard Law School. Le « gagnant-gagnant » est consacré comme idéal de compromis. Pourtant, rien d’innovant chez la “Harvard compagnie” ! Mais l’idée pénètre alors le management, les affaires, le dialogue social et même médiation, laquelle n’est au demeurant qu’une conception de la négociation pilotée par un tiers. Rien à voir avec la qualité des relations humaines. Ici, on échange, on solde, on trafique, on joue sur la bienveillance, tout se quantifie et se marchande. Le raisonné est chargé de la morale du raisonnable. Pourtant, cette diffusion repose sur une hypothèse implicite : que tous les acteurs sont présents, informés et libres. Or, dans la plupart des cas, le « gagnant-gagnant » est conclu au détriment d’un absent — celui qui ne peut pas négocier, celui qui est contraint au silence, celui dont les coûts sont externalisés. Le perdant ne saura rien de l’accord, il le subira au nom des grands principes de la légalité, aux détours éventuels des ententes illicites. Quand les accords semblent « gagnant-gagnant », c’est par acceptation préalable des postures, un jeu de dominant-dominé.
4. Conséquences sociales, politiques, professionnelles et familiales
- Politique : les compromis « gagnant-gagnant » se traduisent par des équilibres budgétaires qui satisfont les acteurs en présence, mais laissent de côté les citoyens invisibles ou les générations futures.
- Professionnel : dans l’entreprise, le discours du « gagnant-gagnant » masque souvent une répartition inégale de la valeur, où les salariés ou sous-traitants non invités à la table paient le prix.
- Familial : dans les conflits privés, présenter une solution comme « gagnant-gagnant » peut être ressenti comme insultant : celui qui a perdu un lien, une part de vie ou un projet n’entend pas qu’on lui dise qu’il est « gagnant ».
- Social : la culture du « gagnant-gagnant » imprègne le langage quotidien et colonise les émotions, transformant tout en équation de rentabilité affective.
Ces conceptions sont largement diffusées dans toutes les formations où l’idée de négociation s’est propagée : management, gouvernance, dialogue social, résolution de différends, si bien que maintenant, elles sont fortement ancrées et apparaissent comme des vérités en une seule : gagnant-gagnant répond à un idéal possible, alors même que c’est une aberration.
5. Illusion et biais
En réalité, un conflit ne se résout jamais sans perte. Sans avoir déjà perdu. On ne gagne pas sur le cadavre d’une relation. La meilleure issue n’est pas de « gagner », mais de perdre le moins possible. L’idée de créativité attachée au « gagnant-gagnant » est trompeuse : elle ne stimule pas l’imagination libre, mais renforce un cadre compétitif où chacun calcule son gain relatif. Dans tous les cas, l’asymétrie relationnelle empêche une égalité parfaite. Le « gagnant-gagnant » est une fiction binaire, une rationalisation qui occulte la violence symbolique ou matérielle faite à ceux qui ne sont pas autour de la table, voire à ceux qui sont contraints par une modélisation des rapports sociaux et politiques.
Conclusion : dépasser le biais, valoriser la qualité relationnelle
Le « gagnant-gagnant » n’est pas une vérité universelle, mais une construction idéologique nourrie par l’esprit du temps : celui des marchés, du calcul, de la rentabilité généralisée. Les médiateurs professionnels ne peuvent pas se contenter de propager cette fiction. Leur rôle n’est pas de promettre des victoires illusoires, mais de restaurer la qualité relationnelle, d’inclure les parties absentes, d’ajuster les déséquilibres et de clarifier les pertes réelles. La médiation professionnelle (cf. Dictionnaire encyclopédique de la médiation – Au service de la qualité relationnelle et de l’entente sociale – ESF) n’est pas la recherche d’un équilibre fictif entre gagnants, mais la réhabilitation d’une liberté de choix dans les relations.




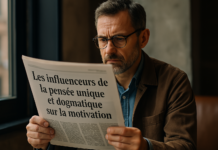

![Livre [nouveauté] : Médiations en milieux hostiles](https://www.officieldelamediation.fr/wp-content/uploads/2023/10/Médiations-en-milieux-hostiles-218x150.png)