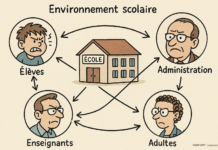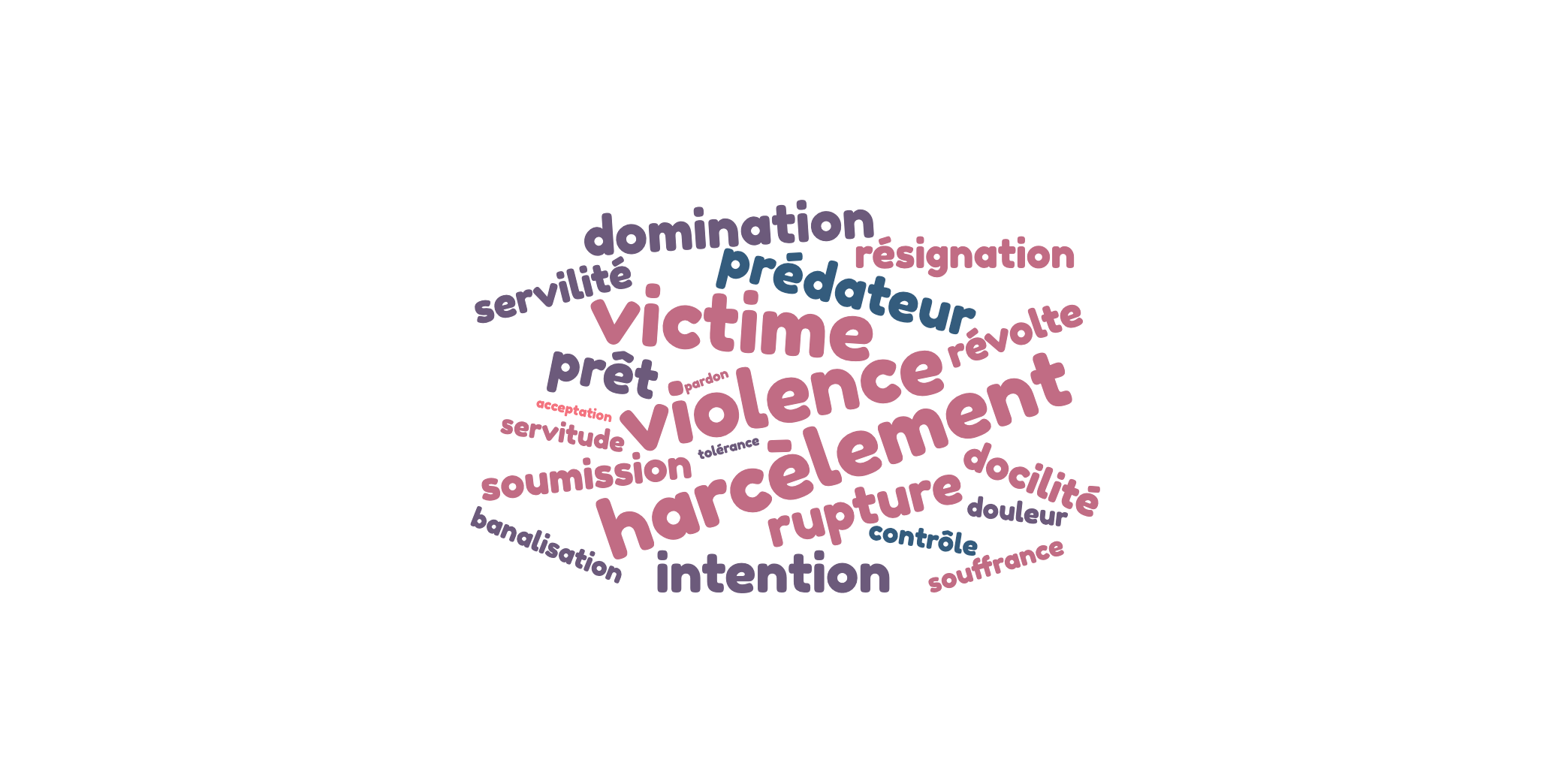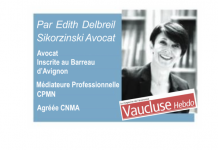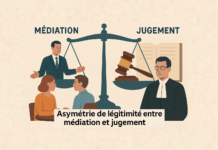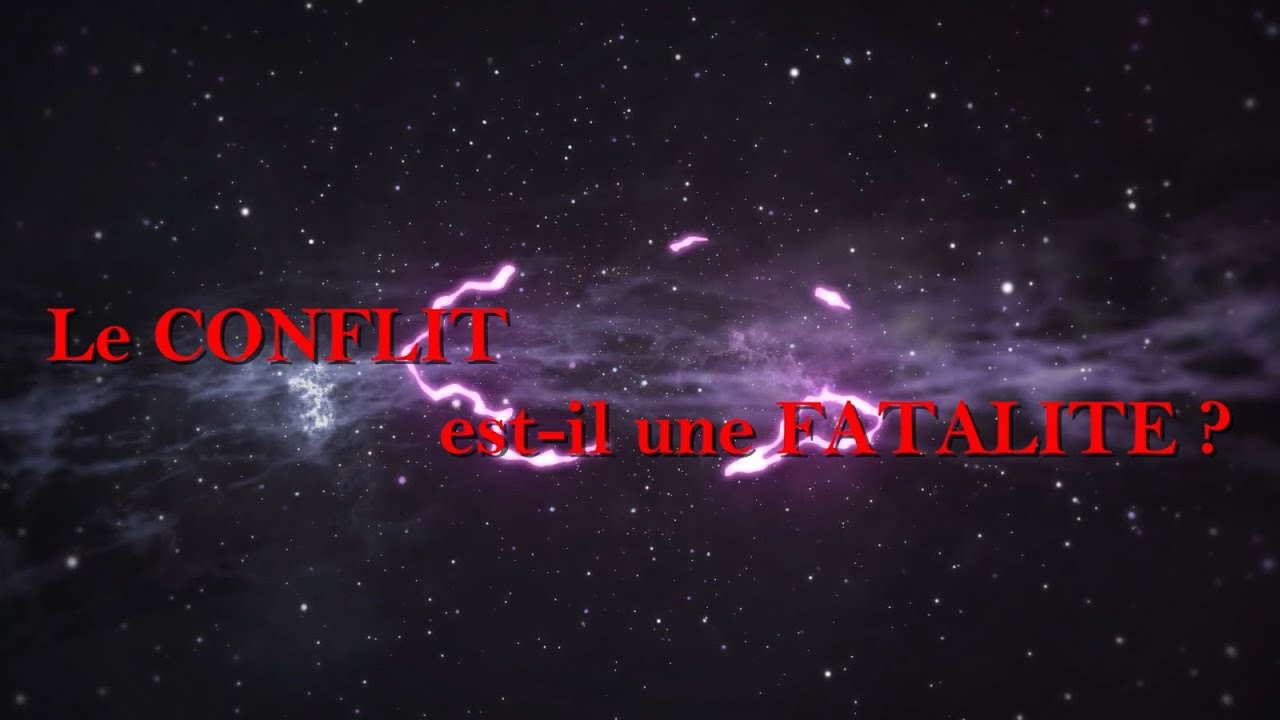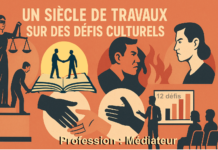La santé mentale, grande cause nationale 2025
Cette année, la santé mentale a été désignée grande cause nationale. Une reconnaissance bienvenue, mais dont le traitement public reste souvent centré sur l’approche psychologique et médicale : une personne dont la santé mentale est dégradée serait une personne “à soigner”.
Or, les médiateurs professionnels rencontrent chaque jour des personnes qui ne vont pas bien, sans pour autant relever d’un suivi thérapeutique. Des personnes traversant des désaccords profonds, des tensions relationnelles, des conflits qui épuisent leur énergie mentale. C’est là qu’une autre lecture devient possible : celle de l’Ingénierie Systémique Relationnelle (ISR).
Une définition à interroger
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé mentale comme :
« Un état de bien-être mental qui nous permet de faire face aux sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler, et de contribuer à la vie de la communauté. »
Cette définition met l’accent sur le bien-être et la capacité d’adaptation, deux notions positives, mais aussi normatives. Elle suppose qu’une personne “en bonne santé mentale” est capable de produire, de s’adapter, de contribuer.
Mais que dire alors de celles et ceux qui traversent un deuil, une épreuve, un conflit, un épuisement ? Leur santé mentale est-elle mauvaise ou sont-ils en train de chercher un nouvel équilibre ?
La santé mentale, un équilibre à construire
Sur le terrain, les professionnels rencontrés, médecins et responsables RH, partagent un même constat : la santé mentale n’est pas un état figé, mais un équilibre mouvant.
Un médecin l’exprime ainsi : « Le mal-être n’est pas forcément un signe de maladie. Il peut être un passage nécessaire, une expérience d’apprentissage. »
Une DRH évoque quant à elle la vie comme un ensemble de “boîtes” : travail, famille, amis, activités… Lorsque l’une est en difficulté, les autres peuvent compenser ou s’effondrer à leur tour.
La santé mentale dépend d’un tissu relationnel global : si une partie se rompt, tout l’équilibre peut vaciller. C’est une vision systémique qui invite à la considérer dans toutes ses dimensions, pas seulement psychologiques : individuelles, relationnelles, organisationnelles.
Quand les relations fragilisent ou réparent
Les médiateurs professionnels accompagnent souvent des personnes épuisées, en tension, ou enfermées dans un conflit. Elles décrivent un état qui “les mine”, “les empêche de dormir”, “les ronge”. Elles arrivent avec une demande relative à un conflit, mais ce qu’elles décrivent c’est une relation difficile, insatisfaisante. La médiation va donc se concentrer d’abord sur l’état de leur relation et son futur.
Souhaitent-elles rester en lien ?
Si oui, comment ?
Sur quelles bases ?
Lorsque ces personnes redéfinissent les modalités de leur relation entre elles et vis-à-vis d’elles-mêmes, elles retrouvent un équilibre mental et émotionnel.
Ainsi la médiation contribue à améliorer leur santé mentale.
Le regard de l’Ingénierie Systémique Relationnelle (ISR)
L’Ingénierie Systémique Relationnelle est une discipline issue de la médiation professionnelle, visant à instaurer ou restaurer des relations de qualité au sein des organisations.
Elle propose une autre manière de comprendre la santé mentale : « La santé mentale est la capacité d’un individu à entretenir des relations constructives avec lui-même et avec autrui, à faire usage de sa liberté de décision, à développer ses compétences relationnelles et à s’inscrire dans des projets personnels et collectifs. »
Cette définition déplace le regard : elle ne parle plus de bien-être, mais de relation, de liberté et de qualité de la relation.
La santé mentale devient alors :
- La capacité à se reconnaître soi-même,
- À exercer un choix libre et conscient,
- À comprendre ses propres émotions et réactions,
- À construire des relations justes et ajustées.
De la prise de conscience à la qualité relationnelle
L’introspection est au cœur de cette approche : c’est la faculté d’observer ses pensées, émotions et comportements, d’en comprendre les mécanismes et d’en ajuster les effets.
Autrement dit, de se voir agir pour choisir plutôt que subir.
Cette lucidité est une compétence relationnelle à part entière — celle qui permet d’interagir en conscience, d’exercer sa liberté de décision et de co-construire avec autrui.
Grâce à cette prise de conscience, chacun peut fonder des liens de qualité, que ce soit dans les équipes, les familles ou les institutions.
Vers une santé mentale en altérité
Là où la définition de l’OMS valorise la résilience et la productivité, la médiation professionnelle propose une approche centrée sur l’altérité (l’accueil de l’autre) et la liberté de conscience.
Elle ne cherche pas à normaliser le bien-être, mais à restaurer la qualité du lien — à soi, à l’autre, au collectif. En somme, la santé mentale n’est pas un état à atteindre, mais une relation à cultiver : un processus d’ajustement lucide, libre et conscient, au service du lien humain.
En conclusion
La médiation professionnelle ne soigne pas : elle éclaire, relie et responsabilise.
Elle redonne à chacun la possibilité de se situer, de comprendre et de choisir.
Et si, plutôt que de “promouvoir le bien-être”, nous apprenions à entretenir nos relations avec nous-mêmes, les autres et nos organisations ?




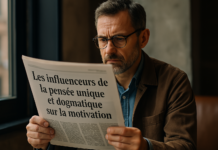

![Livre [nouveauté] : Médiations en milieux hostiles](https://www.officieldelamediation.fr/wp-content/uploads/2023/10/Médiations-en-milieux-hostiles-218x150.png)