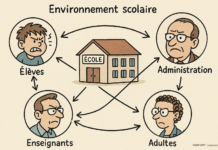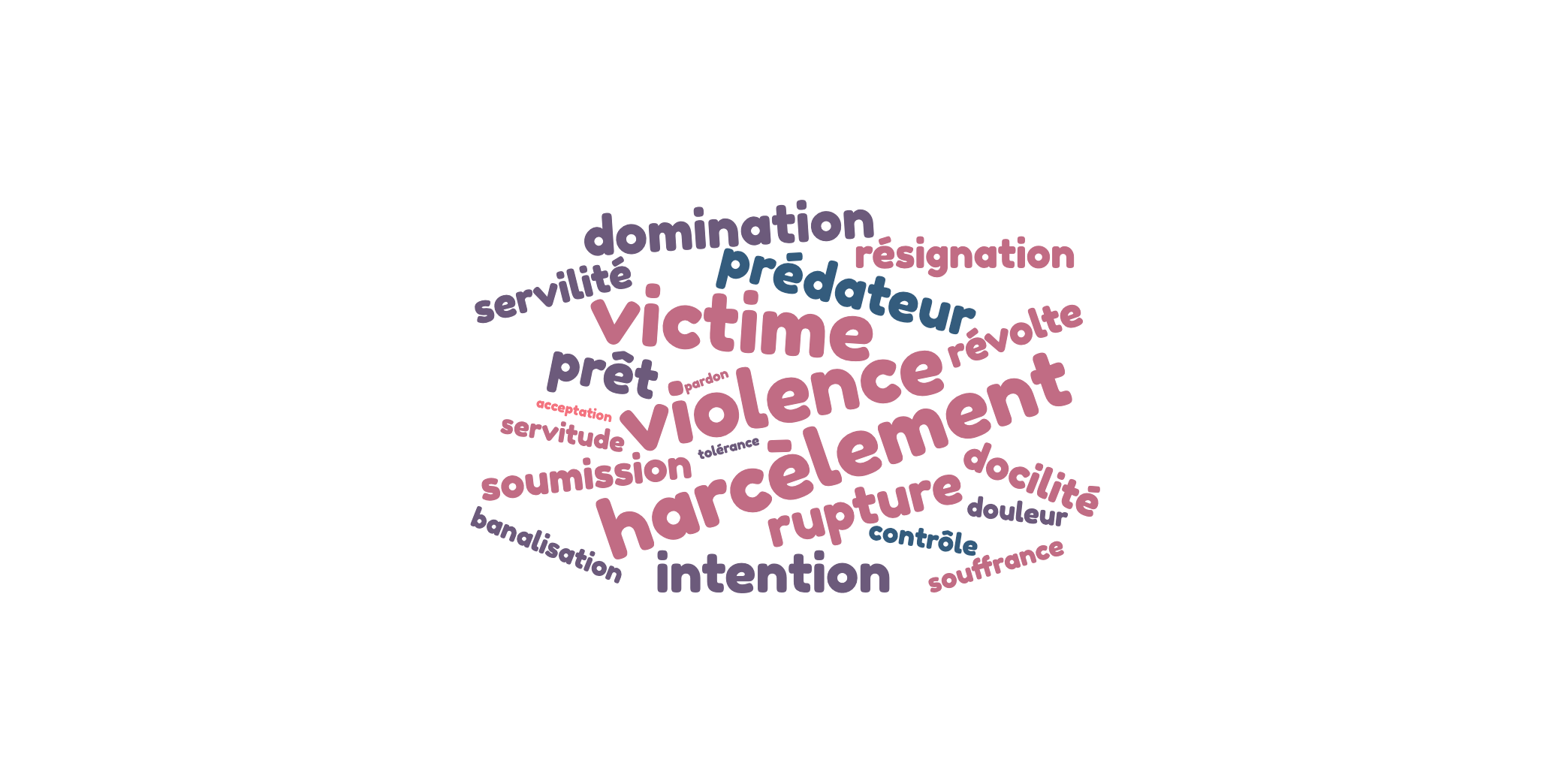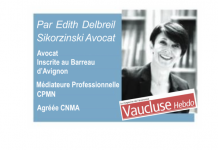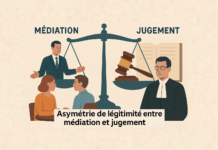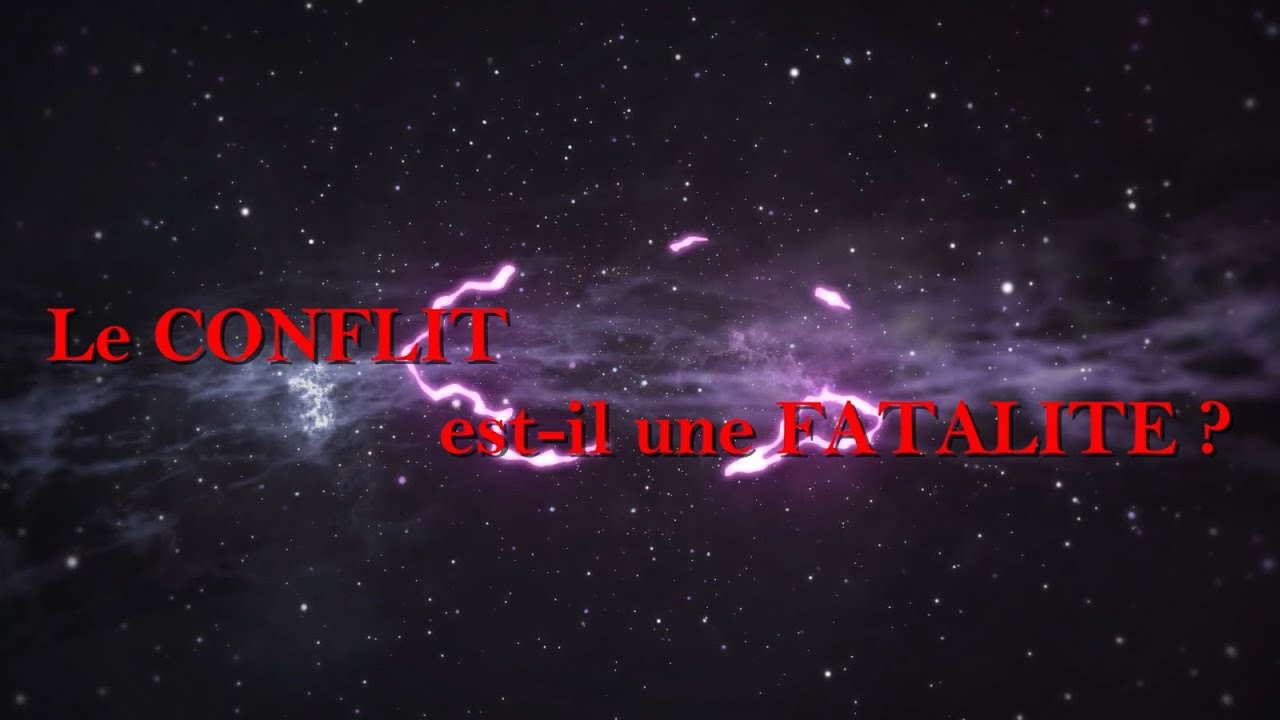La mise en cause de la théorie des besoins de Maslow suscite encore, chez certains professionnels de la formation et du management, très engagés dans les modélisations psychosociales, des réactions virulentes. Certains n’hésitent pas à disqualifier toute critique comme étant le signe d’ignorance ou d’arrogance. L’auteur serait sacré. Pourtant, à mieux y regarder, la solidité de ce modèle s’effondre dès qu’on en examine les fondations. Aurez-vous l’instant de curiosité pour me lire ? Permettez-moi de vous inviter à un plus de connaissances et de références concernant la modélisation de Maslow.
Une théorie de circonstance et de complaisance ?
Maslow n’a jamais construit sa hiérarchie des besoins sur une étude méthodique, scientifique, encore moins statistique. Il l’a lui-même reconnu : sa théorie repose sur des interprétations personnelles, à partir de figures qu’il estimait « exemplaires » — Albert Einstein, Eleanor Roosevelt, Abraham Lincoln, Spinoza… Il cite aussi des cas cliniques, des observations personnelles, et des intuitions issues de sa pratique psychothérapeutique. Aucun protocole, aucun échantillonnage, aucun dispositif de validation empirique.
Une pyramide fidèle… mais révélatrice d’une logique de domination implicite.
Il est donc vain de prétendre que la représentation pyramidale trahit la pensée de Maslow. Elle en est au contraire une traduction fidèle, comme l’attestent ses propres formulations. Ce n’est pas une caricature égyptienne ou incas, mais une réduction graphique assumée.
Dans la première partie de son article « A Theory of Human Motivation » (1943), principalement dans les sections 2 et 3, Maslow écrit :
- “The basic needs are organized into a hierarchy of relative prepotency.” soit: « Les besoins fondamentaux sont organisés en une hiérarchie de prépondérance relative. »
- “This means that the appearance of one need usually rests on the prior satisfaction of another, more prepotent need.” soit : « Cela signifie que l’apparition d’un besoin dépend généralement de la satisfaction préalable d’un autre besoin, plus prépondérant. »
- « Human needs arrange themselves in hierarchies of prepotency », soit : « La hiérarchie des besoins humains est fondée sur la prépondérance relative des besoins »
5 niveaux de besoins non systémiques
Dans cette section, Maslow énumère les 5 grands types de besoins, en partant du plus fondamental :
- Besoins physiologiques : faim, soif, sommeil…
- Besoins de sécurité : stabilité, ordre, protection.
- Besoins d’amour et d’appartenance : relations, amitiés, famille.
- Besoins d’estime : respect de soi, reconnaissance, prestige.
- Besoins d’actualisation de soi (self-actualization) : réalisation du potentiel personnel.
“These basic needs are usually taken as the starting point for motivation theory.”, soit « Ces besoins fondamentaux sont habituellement considérés comme point de départ de la théorie de la motivation. »
L’escalade est clairement formulée comme une progression conditionnelle.
Une modélisation culturelle, linéaire et prédictive
Cette hiérarchie des besoins ne s’inscrit pas dans une logique systémique, mais dans un modèle évolutionniste, guerrier, imprégné d’idéologie de la réussite. C’est une conception issue de son époque, marquée par la montée de l’individualisme économique et l’idéal méritocratique. Cette conception imprègne si fortement les enseignements que même dans les approches neuroscientifiques, des dérives conceptuelles sont identifiables (la théorie de la récompense en fait partie).
Une conception évolutive de la domination et de la supériorité
Si Maslow et ses successeurs ont pu croire en la pertinence d’un modèle hiérarchisé, l’expérience concrète en médiation professionnelle démontre que la motivation humaine n’émerge pas d’une logique prédictive, pas plus que d’un jeu de « carotte et bâton », qui s’inscrit dans des rapports dominant-dominé, mais d’un ajustement à un état présent.
Recontextualiser Maslow dans une lecture systémique exigerait de renier l’intention même de son modèle, fondé sur une progression linéaire et conditionnée : pour l’auteur, l’idée d’une progression conditionnelle était centrale.
Les constats issus des pratiques de médiation professionnelle contredisent frontalement ce modèle. On n’y observe ni hiérarchie fixe, ni progression linéaire des besoins. La motivation y apparaît comme un ajustement à l’instant, non comme la réponse à une privation préalable. Les systèmes de négociation si déployés, fondés sur les rapports aux enjeux et aux intérêts (négociation raisonnée qui vise la représentation du raisonnable, avec morale, droit et norme) montrent leurs propres limites.
Face à ces limites, une autre voie est possible — non pas fondée sur le manque ou l’escalade, mais sur la logique d’interaction dynamique. C’est ce que formalise la Théorie de l’Ajustativité Générale (#TAG) que je propose. Elle offre alternative, fondée non sur des niveaux ou des déficits, mais sur la coexistence de tensions et leur harmonisation présente. C’est le travail qui est réalisé dans ce creuset où nous développons la profession de médiateur, avec les instrumentations spécifiques de l’ingénierie systémique relationnelle®.
Sources et commentaires :




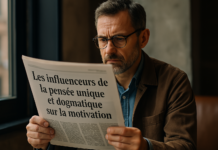

![Livre [nouveauté] : Médiations en milieux hostiles](https://www.officieldelamediation.fr/wp-content/uploads/2023/10/Médiations-en-milieux-hostiles-218x150.png)