Le code de conduite des médiateurs diffusés par la Commission Européenne est un texte obsolète
Depuis 2004, la Commission Européenne fait circuler un Code de conduite européen pour les médiateurs, intervenant en matière civile et commerciale. L’idée a émergé dans la suite des travaux amorcés sur les modes alternatifs de résolution des conflits au sein de la Commission Européenne. Le travail a été réalisé en un mois d’été, en juillet 2004. Selon ce qui est mentionné sur le site de présentation(1), le texte aurait été approuvé et adopté par un grand nombre d’experts en médiation.
A savoir qu’en 2001, et parallèlement à cette initiative précipitée, les médiateurs professionnels (CPMN) lançaient un forum public pour élaborer ce qui allait devenir le CODEOME, le Code d’éthique et de déontologie des médiateurs. Le CODEOME allait devenir la référence en matière d’éthique et de déontologie, tant en France où des regroupements d’associations ont repris abondamment des parties de ce travail, qu’outre Atlantique. Ce travail allait durer quatre années. Quatre années de concertation, de révisions et de reprises avant d’être adopté la première fois en Assemblée générale, en 2006. La dernière mise à jour du CODEOME date des Rencontres annuelles du 16 octobre 2010.
Le texte européen mis à l’étude
Espérant ne pas avoir à poursuivre des travaux ayant abouti ailleurs, la chambre syndicale a examiné le texte publié par la CE. A la lecture, il a été clair que le même état d’esprit n’a pas présidé à la rédaction de chacun des deux codes. C’est pourquoi dès que le texte européen a été connu et malgré l’a priori favorable et la sollicitation de l’équipe européenne de rédaction, la chambre syndicale n’a pas pu y apporter sa caution.
La discussion avec des juristes de la Commission Européenne a permis de savoir qu’aucune exigence n’était attendue de la part des organismes souscrivant à ce code et qu’en réalité aucun contrôle de la nature des compétences pas plus que des qualités des experts n’était effectué. La fiabilité n’était donc pas au rendez-vous. Le texte de la CE est de toute évidence obsolète et devrait être abandonné. La précipitation de sa rédaction n’est pas la seule raison.
Dans ce texte de la CE, la médiation est définie comme une procédure
Le texte de la CE définit la médiation comme une procédure dès l’article 1. Ce point a fait l’objet d’une modification dans la directive européenne lors de l’intervention de la délégation de la CPMN auprès des rédacteurs qui ont reconnu la logique de nos arguments. Le terme de procédure, dans ce domaine, est un terme juridique qui peut inspirer l’idée associée de recours possible jusqu’à la cassation. Lors de la rédaction de la directive européenne, la CPMN a proposé, et ce fut adopté, l’expression de processus structuré. Mais le législateur européen prenait-il en considération que seuls les médiateurs professionnels, c’est-à-dire ceux formés par l’EPMN Médiateurs Associés, maîtrisent un tel processus ?
En tout état de cause, le mot processus n’est pas utilisé une seule fois dans le texte européen, tandis que le mot procédure y est martelé. C’est-à-dire qu’aucune mise à jour du texte européen n’a été réalisé depuis l’adoption de la directive.
La confusion entre neutralité et impartialité
Le travail de clarification, que j’ai réalisé pourtant depuis 2001, sur les mots de postures du médiateur n’apparait évidemment pas dans ce texte où la neutralité est confondue soit avec l’indépendance soit avec l’impartialité. Le rédacteur européen ajoute en confusion avec le vocabulaire revenant à la posture du juge en indiquant que le médiateur doit se comporter de manière équitable.
Or, désormais, le mouvement de la médiation a repris mes définitions pour clairement poser que l’impartialité est relative à la posture du médiateur à l’égard des parties ; que l’indépendance est relative à la posture du médiateur par rapport à une forme d’autorité ou un a priori culturel dominant et que la neutralité est relative à la solution que les parties choisissent pour mettre un terme à leur différend. Le fait de faire intervenir la notion d’équité, par définition subjective, nuit à l’idée même de neutralité.
L’accord sur le recours à la médiation
Le rédacteur européen tend à imposer son propre modèle où selon lui un travail d’information préalable devrait être réalisé en vue de s’assurer que les parties adhérent volontairement à la médiation. Or, les professionnels savent que l’adhésion d’une personne en conflit à un processus visant à dialoguer avec la partie adverse ne s’obtient pas par un travail d’information, mais un échange permettant à la personne de trouver une meilleure posture d’affirmation de ses besoins, points de vue et intérêts.
Le rédacteur européen indique que « S’il l’estime utile, le médiateur peut entendre les parties séparément. » Il suggère ainsi que la pratique la plus normale de conduite d’une médiation est de recevoir les parties ensemble. Or, le professionnel sait que pour réaliser une médiation, il est indispensable de recevoir séparément chacune des parties, précisément pour leur permettre de définir clairement leur manière de concevoir le déroulement de la médiation et son éventuel aboutissement.
Le rédacteur européen indique que le médiateur pourrait mettre fin à la médiation dans deux cas :
- si l’accord en passe d’être conclu lui paraît impossible à exécuter ou illégal, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la compétence du médiateur pour en juger ;
- il estime peu probable que la poursuite de la médiation permette de parvenir à un accord.
Ce faisant, le médiateur est enfermé dans un rôle équivoque de garant juridique et moral. Quelle est la bonne mesure de ce qui paraît à une personne, surtout compte tenu de la compétence ? Dans ce contexte, n’aurait-il pas mieux valu préférer l’incompétence ? Et dans le même ordre d’idée, arrêter une médiation parce que l’accord est estimé peut probable relève d’une appréciation tellement personnelle qu’il est de toute évidence abusif de confier une telle mission dans ces conditions.
Pour les médiateurs professionnels, un médiateur arrête son intervention, mais pas la médiation. Si les parties souhaitent poursuivre, elles doivent pouvoir trouver un professionnel pour les accompagner. L’incompétence de l’un ou ses limites d’acceptation ne doivent pas faire limiter l’implication des parties dans leur recherche de résolution.
L’ensemble de ces points montre la fragilité d’un texte qui devrait revenir sur la table du rédacteur européen et en tout état de cause ne devrait pas être utilisé comme garantie quelconque du sérieux de médiateur. Car, en effet, il témoigne d’une vision totalement faussée et inadaptée de la médiation.
== Sources==
(1) réseau judiciaire européen qui ne précise ni le nombre ni le nom du moindre experts



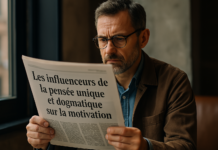

![Livre [nouveauté] : Médiations en milieux hostiles](https://www.officieldelamediation.fr/wp-content/uploads/2023/10/Médiations-en-milieux-hostiles-218x150.png)


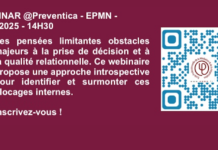






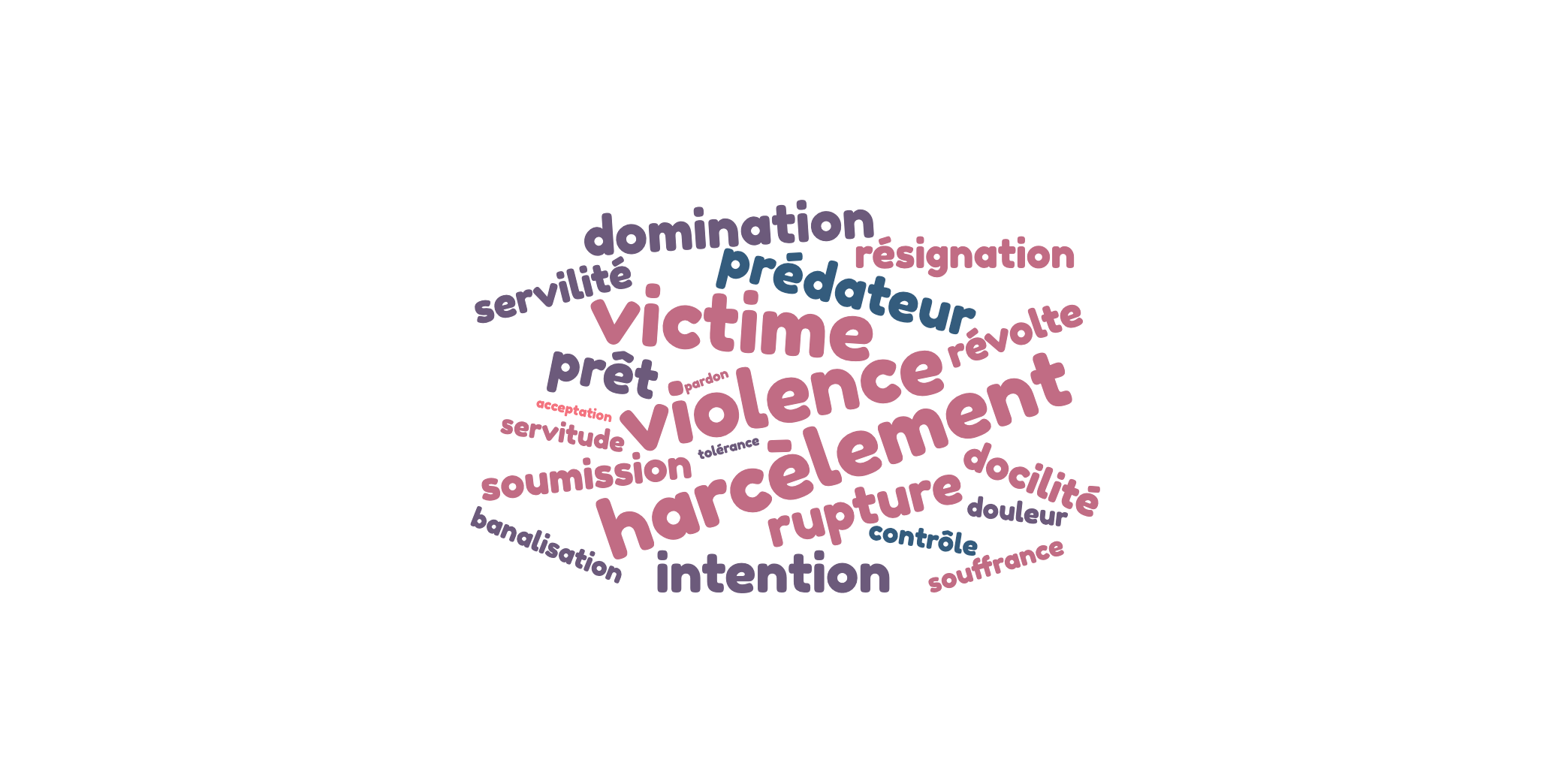
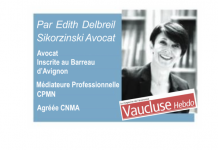




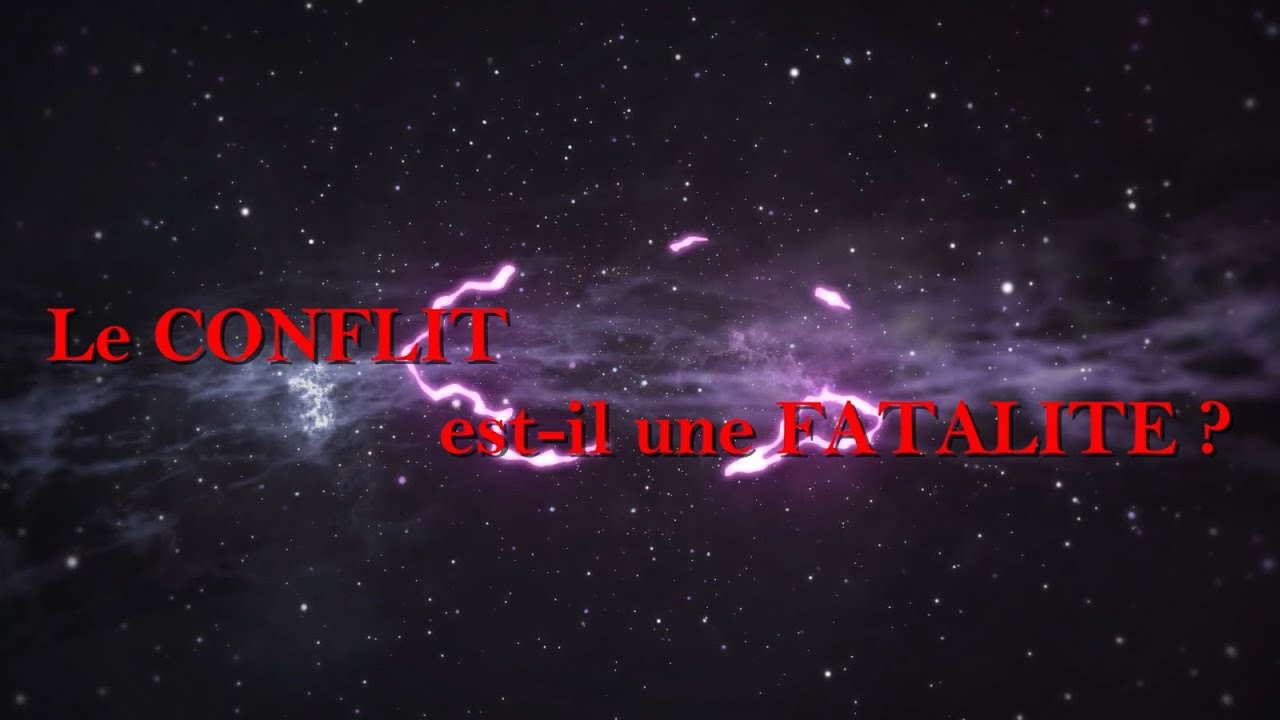





Je constate que des organisations se réclame du respect de ce texte conçu à la va vite. Il convient d’insister sur la nécessité de la rigueur en médiation, c’est la garantie de la qualité de la prestation des médiateurs. Si cette rigueur fait défaut dès la référence à l’éthique, alors la crédibilité s’y perd aussi sûrement.
Alors que la France engage le processus de transposition de la Directive européenne du 21 mai 2008 relative à certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, Jean-Louis Lascoux souligne à juste titre la fragilité et l’obsolescence du Code de conduite européen pour les médiateurs élaboré en 2004, auquel se réfère le Conseil d’État dans son rapport « Développer la médiation dans le cadre de l’Union Européenne » du 29 juillet 2010.
A l’évidence, ce texte devrait être actualisé et mis en conformité avec les dispositions de la Directive, laquelle est-il besoin de le souligner, a été adoptée quatre ans après l’établissement du code de conduite. Ce décalage dans le temps, explique en partie mais pas seulement, les contradictions relevées par Jean-Louis Lascoux. Quoiqu’il en soit, la Commission européenne devrait en tirer rapidement les enseignements, et si possible avant le 21 mai 2011, date à laquelle sa directive doit au plus tard être transposée.
Il est certainement aussi de la responsabilité des pouvoirs publics français d’œuvrer en ce sens, d’autant que le Conseil d’État préconise d’insérer dans le Code de procédure civile la disposition suivante relative à l’obligation d’information : « le juge informe la personne physique ou l’association a qui est confiée la médiation de l’existence du code de conduite européen pour les médiateurs et du code de déontologie du médiateur »
Si la volonté française est de « s’aligner sur les exigences élevées de la médiation intercommunautaire » et de ne pas faire coexister « dans notre droit deux régimes de médiation distincts selon la nature des litiges », il convient qu’elle lève toutes les ambiguïtés et incohérences introduites par le code de conduite européen des médiateurs qui portent atteinte au processus structuré par lequel les parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur, que ce processus soit engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescrit en droit interne.
Les commentaires sont fermés.