 Etre conseiller aux prud’hommes est une fonction frustrante pour ceux qui cherche à concilier les parties, car à ce jour il y a un pourcentage d’échec en conciliation assez fort.
Etre conseiller aux prud’hommes est une fonction frustrante pour ceux qui cherche à concilier les parties, car à ce jour il y a un pourcentage d’échec en conciliation assez fort.
Une procédure étouffante : une petite pièce où se trouve sept personnes (le greffier, les deux conseillers, les parties avec leur avocat ou défenseur). Un perpétuel défilé de robes passent et repassent. Juste le temps de voir si le dossier est prêt pour le jugement. Le silence des protagonistes qui se laissent entrainer par le mouvement des prises de parole de leurs avocats et défenseurs syndicaux.
Trop souvent les employeurs n’assistent pas à cette étape. Le contradictoire est respecté malgré l’absence du client car il est représenté par son avocat qui parle en son nom. Un cadre rigide avec des obligations de procédures et des parties qui évitent d’avancer une possible entente, d’énoncer des chiffres, car le juge qui est en conciliation sera celui du jugement et pourrait retenir les propositions faites lors de la conciliation.La structure est trop lourde pour imaginer d’aborder les conflits d’une manière différente en faisant réfléchir les personnes sur leur position face au litige.
Il y aurait un grand pas de fait, si les juges prenaient leur mission dans l’intérêt premier de chaque partie : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties » l’article 21 du CPC. Ils peuvent aller jusqu’à désigner un médiateur : article 131-1 et suivant du NCPC : « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. »
Mais pour cela il faut que les conseillers soient dans une démarche d’adhésion à la médiation celle qui transforme une situation d’adversité vers une démarche de reconnaissance.Je suis persuadée qu’il faut un apport pédagogique aux conseillers prud’homaux. Les organismes syndicaux (salariaux et patronaux) doivent accepter de compléter leurs formations de droit en y intégrant de la médiation pour que le passage en conciliation soit un accompagnement de la réflexion vers une relation d’altérité.




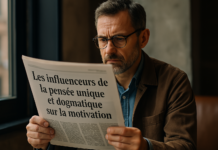

![Livre [nouveauté] : Médiations en milieux hostiles](https://www.officieldelamediation.fr/wp-content/uploads/2023/10/Médiations-en-milieux-hostiles-218x150.png)

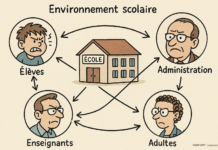





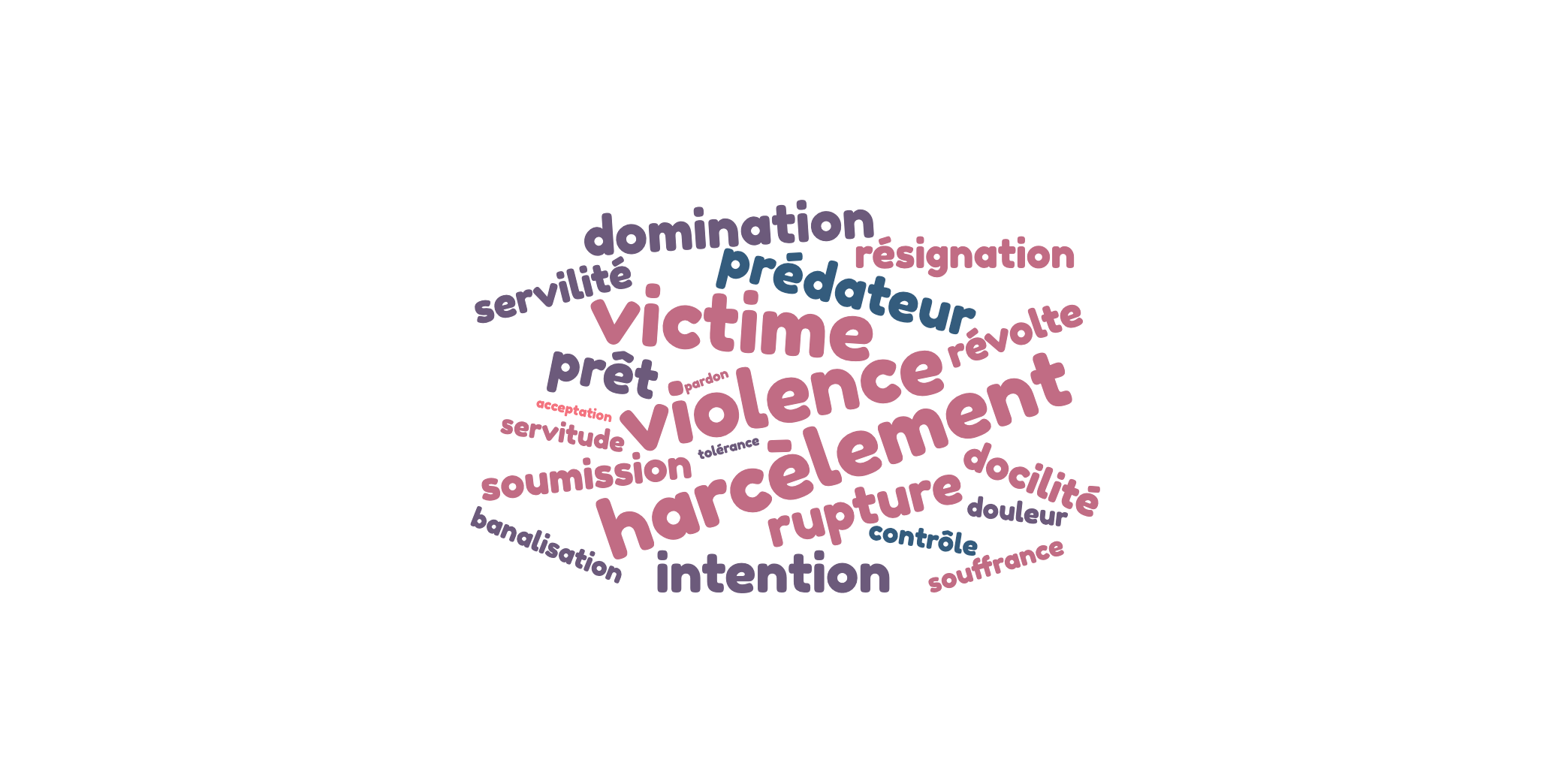
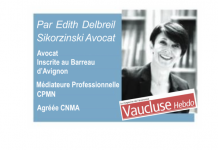

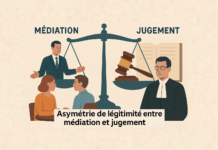



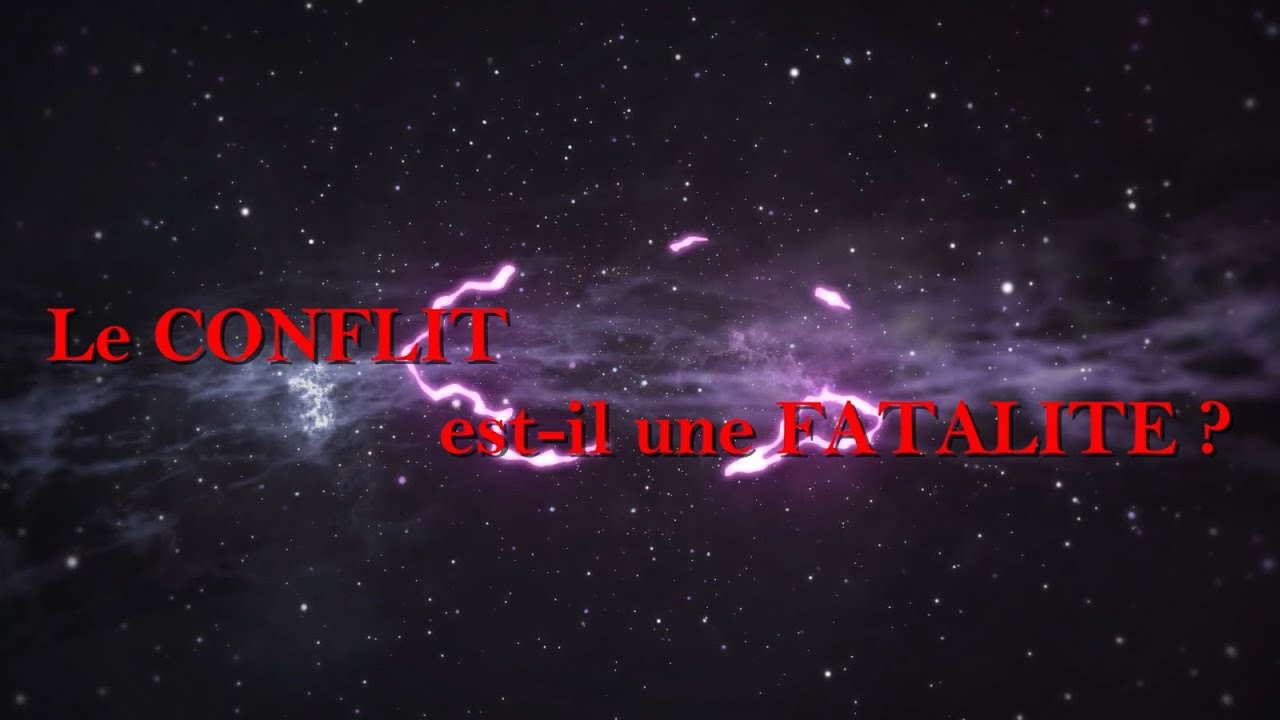








A l’évidence l’institution prud’homale aurait tout à gagner à former ses juges à la médiation. Reconnaître les parties dans leurs états émotionnels, pour les amener ensemble à trouver un accord mettant fin à leurs différents sans contraintes procédurales, pourrait être salutaire pour ses usagers. A n’en point douter, une formation à la médiation intégrée à la formation initiale des conseillers pourrait être de nature à favoriser une prise de conscience de l’instititution à se réformer dans ses pratiques. Il est en effet particulièrement dommageable que la conciliation prud’homale ne réussisse qu’environ pour 10% des saisines, alors qu’en comparaison au Royaume Uni les procédures se concluent pour plus de 50% des cas par un accord des parties. « Une des raisons de cet échec est sans doute que la franchise des parties lors de la conciliation, utile à la réussite de cette première étape, est difficile en France, compte tenu du fait que les juges qui la prennent en charge sont les mêmes que ceux qui traitent la suite du contentieux (cf. Rack, 2006).
Face à constat, nous ne pouvons que nous accorder sur la nécessité de rendre plus efficiente la conciliation (cf. Refondation du droit social Jacques Barthélémy et Gilbert Cette, 2010). Ne conviendrait-il pas pour avancer sérieusement sur ce terrain, opérer une distinction fondamentale entre la conciliation et la médiation, en s’affranchissant du débat sémantique entrenant la confusion dans l’esprit des justiciables et parfois dans celui des juges. S’il rentre bien dans la mission du juge de concilier les parties (art 21 du CPC), le juge prud’homal ne désigne pas de médiateur sur les fondements des articles 131-1 et suivants du même Code de procédure civile. Ceci revêt toutefois une exception majeure, dès lors que les contentieux portent sur des différents collectifs du travail tel que la contestation de licenciements collectifs (procédure et plan de sauvegarde de l’emploi) qui relèvent non pas du Conseil des Prud’hommes mais du Tribunal de Grande Instance. Dans ce cas, le juge, y compris celui de l’urgence, tout en exerçant sa mission de conciliation, peut demander aux parties d’entrer en médiation. Pour autant, sa décision paraît devoir être subordonnéeà l’application de la Directive Européenne du 21 mai 2008, notamment au regard de la neutralité, l’efficacité, la compétence et la formation du médiateur désigné avec l’accord des parties pour parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec son aide. Du seul point de vue du droit européen, le juge ne peut-être à la fois conciliateur et médiateur.
La formation à la médiation des conseillers prud’homaux serait effectivement un premier pas pour que la phase de conciliation constitue un accompagnement de la réflexion vers une relation d’altérité. Encore faudrait-il que l’obligation légale de présence effective des parties soit respectée, que les juges de conciliation ne soient pas parmi les quatre membres jugeant au fond et que plus fondamentalement la médiation puisse être systématiquement proposée par le Conseil des Prud’hommes à l’ouverture de la procédure de conciliation.
Etant aux Prud’hommes section Commerce sis à Bordeaux, je tiens à apporter un bémol concernant l’assertion « le juge qui est en conciliation sera celui du jugement et pourrait retenir les propositions faites lors de la conciliation. »
Il est rarissime, voire quasi improbable, (sauf à dire si le Président de séance le précise) qu’un juge retrouve au bureau de jugement un dossier qu’il aurait eu en conciliation. D’autre part, les propositions ne sont pas davantages inscrites au plumitif si elles ne sont pas abouties. Dès lors, peu de risques que les juges s’en servent au bureau de jugement (d’autant que l’affaire est plaidée sur le fond à ce moment là).
Par ailleurs, nous nous heurtons souvent (en conciliation) au refus de la part des Avocats, de nous laisser seuls en présence de leur client. Il devient donc urgent de leur démontrer que nous ne sommes pas leurs « pique-assiettes ».
Aussi mille fois oui, il est indispensable que tous Conseillers (quelqu’ils soient) aient une formation de Médiateur, ne serait-ce déjà que pour avoir la même culture et arriver à un résultat commun.
Les commentaires sont fermés.