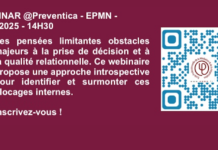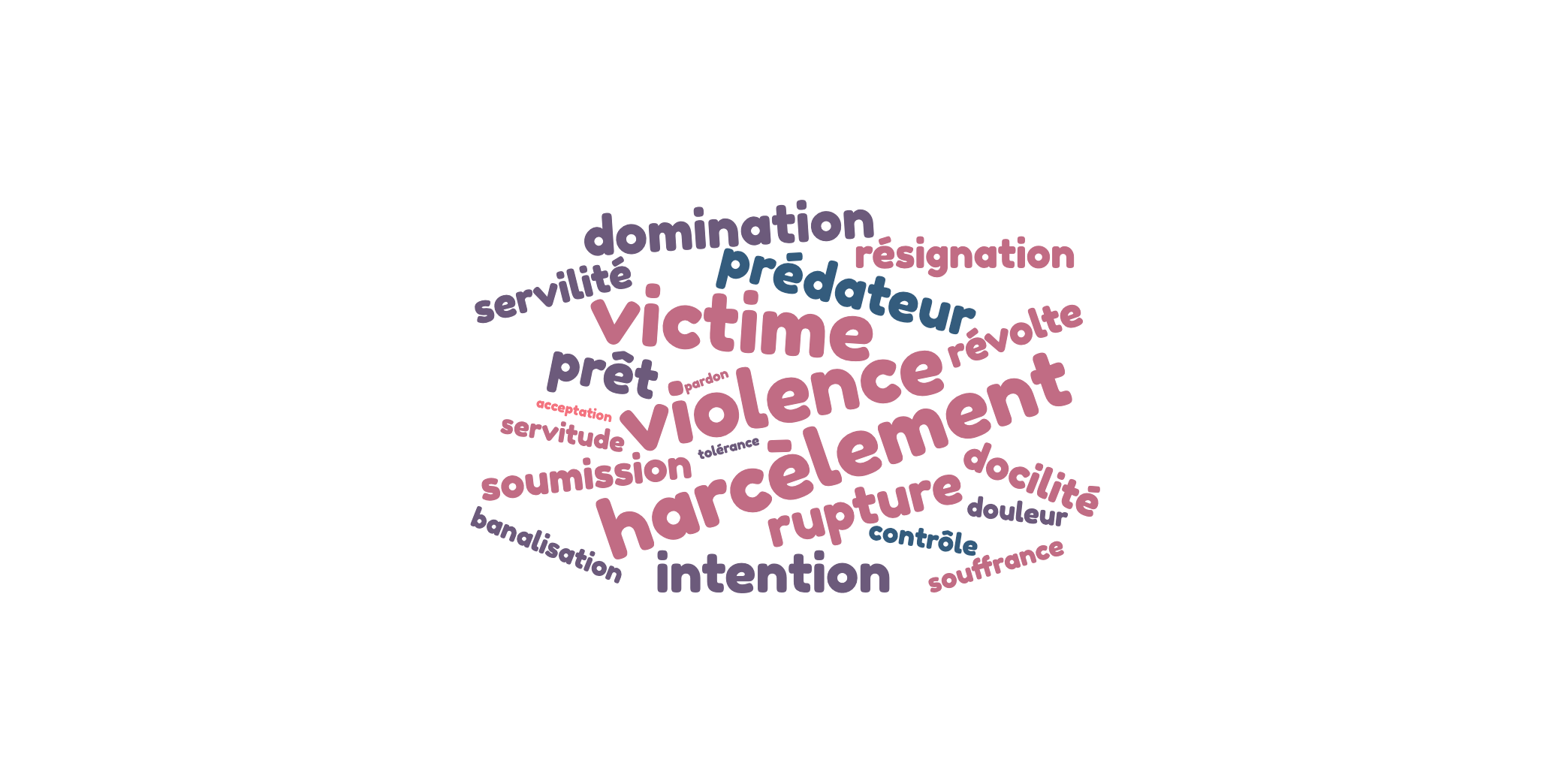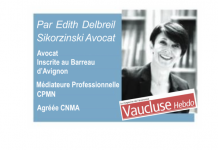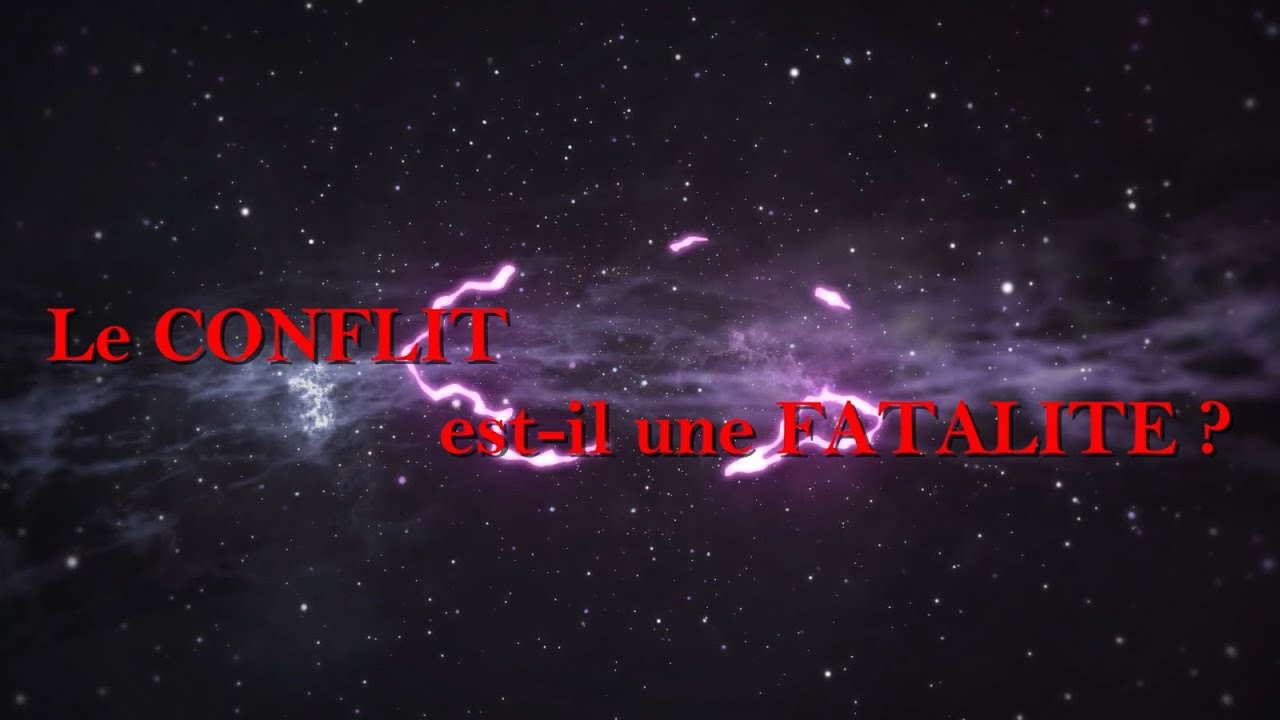Le 19 décembre 2024, la Commission d’Evaluation et de Contrôle de la Médiation de la Consommation, présidée par Marc El Nouchy, avec son secrétariat de la DGCCRF, a organisé au ministère des finances, à Paris, une rencontre hybride avec les médiateurs de la consommation des services publics et des entreprises privées. Ils étaient nombreux à être venus partager et écouter les aspirations pour faire évoluer ce dispositif innovant.
Article publié le 26 décembre 2024
sur le Village de la Justice
Quelques repères historiques de la médiation de la consommation
Choisir entre l’entente et la gestion des droits et obligations pour résoudre les différends de la consommation
L’histoire du droit de la consommation nous fait remonter à l’époque de la montée consumériste, quand la protection du consommateur est apparue devenir une nécessité impérieuse (le Code spécifique a été institué par la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992). Tandis que les intérêts des entreprises sont considérés dès le début du 20ème siècle, c’est plus de 70 ans plus tard que le client commence à avoir des droits reconnus (loi de 1972 sur le démarchage et loi sur le crédit en 1978) et un principe de protection sur la charge de la preuve. Désormais, la médiation de la consommation fait partie de l’arsenal. Mais pourquoi ?
La vie en société connaît une intensification des échanges dans tous les domaines, associée à une montée des frustrations. Néanmoins, tandis que les jeux médiatiques alimentent la perception d’un monde en tension, malgré les intransigeances, les recherches d’entente progressent. C’est dans ce contexte que la médiation de la consommation s’impose comme un outil clé. Pour autant, faut-il se limiter à des aspects gestionnaires, d’économie financière et de temps ? N’est-ce pas avant tout l’entrée dans une ère de civilisation qui s’ouvre sur l’altérité, dont la mondialisation est parmi les plus flagrantes manifestations ? Sachant que les différends sont liés à des aspects émotionnels, faut-il maintenir la primauté de leur traitement technique et juridique ?
La médiation consumériste : une extension de la liberté contractuelle
Au quart du 21ème siècle, le concept de médiation, encore polysémique, incarne cependant un profond renouvellement des relations humaines. Il présente un fort potentiel pour renforcer la liberté contractuelle, par l’élargissement du dialogue amiable, et s’inscrit comme un complément à la relation entre consommateurs et professionnels. Cette pratique privilégie la décision collaborative, fondée sur la Qualité Relationnelle en dépassant les rigidités du droit traditionnel.
Ce mode de règlement reconnaît que la majorité des différends découlent de problématiques relationnelles, plus que techniques ou juridiques. En rendant la médiation accessible à tous, il devient possible de désengorger les dispositifs institutionnels classiques souvent perçus comme réservés à des spécialistes.
Reconnaître le droit à la médiation et inverser le paradigme
Pour inscrire durablement la médiation dans les pratiques sociétales, il est essentiel de :
- Constitutionnaliser le droit à la médiation : rendre ce mode de règlement obligatoire, pour préserver l’exercice de la liberté, avant toute autre intervention, à l’image d’autres dispositifs préventifs comme l’éducation obligatoire ou la ceinture de sécurité ;
- Inverser le paradigme philosophique : faire du droit un outil au service de la médiation, et non l’inverse ; placer ainsi le système judiciaire en tant qu’alternative d’autorité ;
- Développer des dispositifs mutualisés : encourager les entreprises et institutions à intégrer la médiation pour les relations internes et externes, en formant des collaborateurs à des référentiels managériaux innovants issus des recherches en ingénierie relationnelle.
De plus, l’impact de la médiation peut être augmenté grâce à l’intelligence artificielle (IA), notamment pour l’élaboration des propositions de règlement dans des contextes de blocages et pour favoriser une réflexion sur les limites d’acceptation.
Identifier et surmonter les freins à la liberté relationnelle
Les litiges entre consommateurs et professionnels persistent lorsque les relations s’enveniment, même si des solutions techniques existent. Ces situations mettent en évidence des obstacles relationnels bien identifiés :
- Prêts d’intention négative : attribuer à autrui des motivations non fondées, nourrissant les malentendus ;
- Interprétations jugeantes ou dénigrantes : attitudes dévalorisantes qui détériorent le dialogue ;
- Contrainte : imposition autoritaire de volontés ou restrictions ;
- Entêtement : refus de s’ouvrir au dialogue ;
- Absence de reconnaissance mutuelle : empêchant tout rapprochement ;
- Manque d’altérité : incapacité à percevoir l’autre dans sa singularité.
Ces freins montrent que la conflictualité ne réside pas dans des enjeux purement juridiques ou techniques, mais dans les relations elles-mêmes. Le fonctionnement gestionnaire du cerveau n’est pas son seul référentiel et l’évolution met l’accent sur des conceptions plus en lien avec l’évolution elle-même. Ainsi, le médiateur, en actualisant sa conception des relations humaines, devient un acteur essentiel pour valoriser ce qui fonde, construit ou dégrade une relation. Il est un acteur moderne d’une culture soucieuse d’éthique et d’altérité.
Apprendre l’exercice de la liberté relationnelle
La médiation repose sur un travail collectif et personnel, intégrant pleinement la liberté relationnelle. Cela implique :
- Diversifier sa pensée : développer rationalité, adaptabilité et créativité ;
- Dynamiser sa communication : privilégier une expression claire favorisant la compréhension mutuelle ;
- Démultiplier sa réceptivité : reconnaître les biais cognitifs et les mécanismes de perception.
Ce processus soutient le développement d’une profession centrée sur ce qui constitue une relation, ce qui la construit et ceux qui la portent. La chambre professionnelle de la médiation et de la négociation – CPMN structure ces pratiques selon une éthique et une déontologie adaptées aux enjeux de notre époque.
Vers une médiation professionnelle universelle et accessible
Dans les contextes des problématiques relationnelles la médiation possède déjà des impératifs de posture et de garantie qui se sont clarifiés dès les années 2000 : l’indépendance relative à toute forme d’autorité, la neutralité relative aux formes de solution et l’impartialité relativement aux positionnements, enjeux et intérêts défendus par les parties, ainsi que le principe de confidentialité.
Désormais, par delà les limites de la prolifération législative, la médiation, avec sa technicité professionnelle, ouvre la voie au rétablissement d’une entente. Appliquée à la consommation, elle n’est pas seulement un mode alternatif de résolution des différends, mais une opportunité d’étendre la liberté contractuelle grâce à la Qualité Relationnelle appliquée dans le commerce, sans distinction de spécialisation.



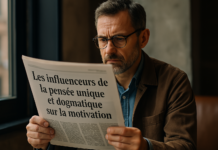

![Livre [nouveauté] : Médiations en milieux hostiles](https://www.officieldelamediation.fr/wp-content/uploads/2023/10/Médiations-en-milieux-hostiles-218x150.png)